NB : les textes de cette page ont été rédigés en grande partie à partir de la presse d'époque. Ils sont donc, quelquefois, imprécis, incomplets. Ils seront corrigés et complétés au fur et à mesure.
Les pertes de l'aviation militaire pour l'année 1913 :
Ltt Raymond Porteau (+01/03/1913 au camp d'Avord / 1er tué de l'école d'Avord) – Ltt Léon René Bresson (+28/03/1913 à Verdun) - MdL Henri Chanroux (+02/04/1913 à Amiens) - Adj Jean-Louis Faure (+02/04/1913 à Toussus-le-Noble) - Cne Pierre Clavenad (+17/04/1913 à Noisy-le-Grand / Accident du ballon militaire Zodiac) – Sgt Henri Richy (Aérostier / +17/04/1913 à Noisy-le-Grand / Accident du ballon militaire Zodiac) - Ltt Hilaire de Vasselot de Régue ( +17/04/1913 à Noisy-le-Grand / Accident du ballon militaire Zodiac) - Cne Henri de Noue (Aérostier +17/04/1913 à Noisy-le-Grand / Accident du ballon militaire Zodiac) - Ltt René de Blanmont (+21/04/1913 à Villacoublay) – Ltt Louis Battini (+04/05/1913 à Saint-Cyr) - Ltt Jean de Kreyder (+30/05/1913 au Camp d'Avord) – Sapeur de Bever (+18/06/1913 à Villesauvage) - Cne Paul-Louis Rey (+02/07/1913 à Mongenost) - Caporal Lamarle (+22/07/1913 à Mourmelon) – Ltt Georges Sensever (+25/08/1913 à Villacoublay) - Sapeur Louis Laforgue (+25/08/1913 à Villacoublay) - Ltt Jean Cazés (+22/09/1913 au large de Mogador) - Ltt Auguste Souleilland (+24/09/1913 sur le terrain d'aviation d'Oudjda) - MdL Hurtard du centre de Reims (+04/10/1913 à Sézanne) - Cal Jean-Pierre Laverlochère de l'escadrille D 6 (+04/10/1913 à Perthes) - Ltt Gabriel Garnier du centre d'aviation militaire d'Epinal (+20/10/1913 à Prez-sous-Lafauche) - Sapeur Jenrot du centre d'aviation militaire d'Epinal (+20/10/1913 à Prez-sous-Lafauche) - Cal Guy de Loynes d'Autroche du centre d'aviation militaire d'Epinal (+20/10/1913 à Dogneville près d'Epinal) - Cne Paul de la Garde au centre de Reims (+12/11/1913 à Villacoublay) - Ltt Fernand Briault (+26/11/1913 à Béthon) - Sapeur Emmanuel Brouillard (+26/11/1913 à Béthon).
Nominations au Journal Officiel :
Le Journal Officiel publie les nominations au grade de chevalier de la Légion d'Honneur du service de l'Aéronautique militaire : Cne Nègre - Ltt Bin - Ltt Edmond Gaubert - Ltt Van den Vaero - Ltt Tay Do-Hû-Vi - Ltt Paul de Canteloube de Marmiès - Cne Jacques Faure (artillerie) - Ltt Maillols - Cne Do (Génie) - Ltt Philippe Féquant (Infanterie Coloniale).
Sont décorés de la Médaille Militaire : Adj Allemand - Adj Girard - Adj Emmery - Adj Comberond - Sgt Thomain - Soldat Séguin - Sgt-Major Guyon - MdL de Beausire de Sayssel - MdL Maurice Bauwens - MdL Marcel Feierstein.
Tous pour service exceptionnels rendus à l'aéronautique militaire.
Mort de l'Enseigne de Vaisseau Bérode :
L'enseigne de Vaisseau Bérode, qui avait été blessé à la tête par l'hélice d'un avion dans la plaine Saint-Anne, le 31 décembre, est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital de Remiremont, le 1er janvier 1913. Habitant Cherbourg, il était détaché à l'escadrille des sous-marins de Brest et assurait les fonctions de commandant en second du sous-marin Floréal. Lors de l'accident, il était en permission à Epinal, chez son père, commandant du 149ème régiment d'infanterie. Il avait 30 ans.
Un crédit d'un 1.800.000 francs va être affecté à l'organisation d'un centre aéronautique qui va être construit dans les environs de Charleville-Mézières. Il comprendra un dirigeable et une escadrille d'avions dotés de leurs hangars.
Le Général Hirschauer devient inspecteur permanent, le 9 janvier 1913 :
Le général Auguste Hirschauer est nommé inspecteur permanent de l’aéronautique militaire en remplacement du général Pierre Roques, le 9 janvier 1913. Il passe commande de 400 avions.
L'escadrille du Maroc à Mogador :
Le 10 janvier 1913, le MdL Marcel Feierstein a effectué une reconnaissance sur Souk-el-Tléda, parcourant 60 km en 38 mn, à l'altitude de 1000 mètres. Le 14, il rejoint la Palmera dans les mêmes conditions. Il utilise pour ces missions un monoplan Blériot biplace. Il décolle de la plage à marée basse de Mogador car c'est le seul terrain d'atterrissage possible, la ville se trouvant sur une étroite presqu'île. Il est arrivé sur place après un raid de 350 km sans escale entre Casablanca et Mogador.
Le 15 janvier 1913, le général Hirschauer, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, a visité le centre d'aviation militaire de Douai-la-Brayelle, commandé par le Cne Franceron. Le même jour, l'aviateur Gastinger, aux commandes d'un monoplan, a décollé du terrain d'Issy-les-Moulineaux pour réaliser la 2ème épreuve nécessaire à l'obtention du brevet de pilote militaire. Devant joindre successivement Orléans puis Pontlevoy, il a été obligé de se poser à Pontlevoy en raison d'un fort broullard qui couvrait la région.

Présentation du drapeau de l'aéronautique militaire par le Général Edouard Hirschauer à Versailles, le 21 janvier 1913 - Photo mis en ligne par le site Gallica de la Grande Bibliothèque de France.
Le centre d'aviation militaire de Maubeuge :
Le centre d'aviation militaire de Maubeuge est très actif. Placée sous le commandement du Cne Raymond Vence, l'escadrille D 4 est équipée de monoplans Deperdussin à moteur Gnome, 6 biplaces et 3 monoplaces. Parmi ses pilotes, on comptait les Ltt Antonin Brocard, Ulysse Lalanne, Victor Radisson et Jacques Rochette. En ce début d'année 1913, ils effectuaient journellement des vols d'entraînement aux longues reconnaissances aériennes.
Les grandes manoeuvres de 1913 :
L'Etat-Major général a décidé que les grandes manoeuves de 1913 se dérouleront entre les 12ème CA, 16ème CA, 17ème CA et 18ème CA. Ces unités seront engagées dans le quadrilatère Lomiges, Montpellier, Toulouse et Bordeaux, et plus précisément dans une région comprise entre les deux vallées de la Garonne et de la Dordogne, à l'Ouest de la Réole, au Nord d'Agen et au Sud de Cahors. L'EM va envoyer des officiers dans les départements concernés pour déterminer les zones les plus propices en fonction des tactiques à expérimenter, la moins gênante pour les agriculteurs et la moins couteuse pour le trésor public. Les frais prévus s'éléveront à 1.500.000 francs, sans compter les dépenses spéciales pour l'aéronautique qui a un budget à part, la consommation des munitions, la différence entre les soldes en garnison et allocations en manoeuvres et finalement les indemnités à payer aux propriètaires des terrains ou aux communes. Pour les manoeuvres de l'Ouest de 1912, qui se sont déroulées entre Montcontour, Loudun et Tours, ces indemnités se sont élevées à 160.000 francs.
Le centre d'aviation militaire de Reims :
Sur le terrain de Reims-Champagne, les capitaines Fabre, Roisin, les lieutenants Redelsperger, Zapelli, Gauthier, Devienne pilotent tous les monoplans Deperdussin à moteurs Gnôme. Le 27 janvier 1913, en présence du Capitaine de Chaunac, des Lieutenants Gourlez et Simon, l'ingénieur L. Janoir a réceptionné deux Deperdussin monoplaces à moteur Gnôme qui sont affectés au centre d'aviation militaire de Reims.
Le centre d'aviation militaire de Pau :
L'installation des appareils dans les nouveaux hangars du centre d'aviation militaire de Pau est terminée et l'atelier de réparation, qui est en cours d'aménagement, sera bientôt achevé. Le parc aérien comprend 15 monoplans Blériot, dont deux biplaces et un pingouin (appareil incapable de décoller et destiné au roulage au sol). Le commandement de l'école est assurée par le Cne Brutus Casse qui est secondé par le Ltt Léon Brûlé.
A la date du 28 janvier 1913, le Ltt Jean Cazès s'entraîne sur Blériot à moteur Gnôme en vue de l'obtention du brevet de pilote militaire. Trois officiers et 5 sous-officiers viennent d'intégrer l'école. Il s'agit des lieutenants Pierre Saint-Lague, Veyssières, Alphonse Bernard-Thierry et des sous-officiers Maurice Faure, Vansant, Paul Lartigue, Henri Moutach, Noguès.
Très prochainement, des essais de tir aériens seront réalisés par le Ltt Jean Cazès avec un Blériot à moteur Gnôme. Ils seront réalisés avec des projectiles de 3 modèles, respectivement de 875 gr, 1,211 kg et 2 kg. Trois cibles concentriques sont tracées sur le sol et auront un rayon de 75, 150 et 300 mètres.
Le terrain d'aviation de Buc :
A Buc, 5 nouveaux monoplans Blériot type XI, modèle 1913 ont été réceptionnés pour l'armée française, le 28 janvier 1913. Le chef-pilote Edmond Perreyon (civil) était chargé des vols d'essais servant à la prise en compte des matériels.

M. Edmond Perreyon, chef-pilote réceptionneur de l'école Blériot de Buc - Brevet de l'Aéroclub de France n° 313 obtenu en décembre 1910 - Il est titulaire de plusieurs records : de hauteur avec 5.880
mètres, de hauteur avec passager avec 4.920 mètres, de distance avec passager avec la distance de 1.200 kilomètres en reliant Turin-Rome-Turin - Brevet de pilote militaire (dans le cadre de la réserve) n° 179 en date du 13 novembre 1912 - Tué au cours d'un accident aérien sur le terrain de Buc, le 24 novembre 1913 - Carte postale collection Joel Damiens que je remercie pour son aide.
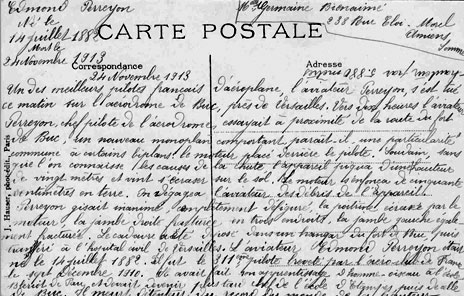
Dos de la carte postale détaillant les circonstances de la mort d'Edmond Perreyon - Carte postale collection Joel Damiens que je remercie pour son aide.
En voici le texte : "Edmond Perreyon - Né le 14 juillet 1882 - Mort le 24 novembre 1913 - Envoyé à Mme Germaine Bienaimé - 238, rue Eloi Morel à Amiens (Somme) - Un des meilleurs pilotes français d'aéroplane, l'aviateur Perreyon s'est tué ce matin sur l'aérodrome de Buc, près de Versailles. Vers dix heures, l'aviateur Perreyon, chef pilote de l'aérodrome, essayait à proximité de la route du fort de Buc, un nouveau monoplan comportant, paraît-il, une particularité commune à certains biplans, le moteur placé derrière le pilote. Soudain, sans que l'on connaisse les causes de la cute, l'appareil piqua d'une hauteur de vingt mètres et vint s'écraser sur le sol. le moteur s'enfonca de cinquante centimètres en terre. On dégagea l'aviateur des débris de l'appareil. Perreyon gisait inanimé, complétement défiguré, la poitrine écrasée par le moteur, la jambe droite fracturée en trois endroits, la jambe gauche également fracturée. Le cadavre a été déposé dans un hangar du fort de Buc, puis transféré à l'hôpital civil de Versailles. L'aviateur Edmond Perreyon était né le 14 juillet 1882. Il fut le 311ème pilote breveté par l'Aéro-club de France, le sept décembre 1910. Il avait fait son apprentissage d'homme-oiseau à l'école Blériot de Pau et devait devenir plus tard chef de l'école d'Etampes, puis de celle de Buc. Il meurt détenteur du record du monde de la hauteur par 5.880 mètres."
L'escadrille du Maroc à Mogador :
Le Ltt Armand des Prez de la Morlais, chef de l'aviation militaire du Maroc occidental, a renouvelé le raid Casablanca-Mogador, sans escale, effectué un mois plus tôt par le MdL Marcel Feierstein comme pilote et le Ltt Van den Vaero comme passager. Le capitaine a effectué le trajet de 350 km en 2 h 40. Il venait relever à leur poste les aviateurs chergés de correspondre avec la colonne du général Brulard, qui opère autour de Modagor. Les aviateurs étaient chargés de la poste et jetèrent un pli officiel à Mazagan. Le Sgt Peretti rejoindra Casablanca après l'installation d'un dépot d'essence en cours de route, car il ne dispose pas encore d'un monoplan à moteur 50 ch. L'état-major est entièrement satisfait des services rendus par l'escadrille. Depuis le 22 décembre, date de l'arrivée sur place des lieutenant Do-Hu et le Sgt Peretti à Mogador, les reconnaissances, (généralement avec les officiers d'état-major, les lieutenants Crémier, Mazel, le Cdt Marti) ont été journalières et ont été effectuées dans un rayon de 50 km autour de la ville. Les avions de l'unité ont parcouru un total de 2.500 km en un mois. Les avions Blériot se comporte bien puisque tous ces vols ont été réussis sans déplorer la moindre panne.

Henri Farman HF 20 de l'escadrille du Maroc en escale à Tozeur, le 27 février 1913 - Carte postale dépoque.
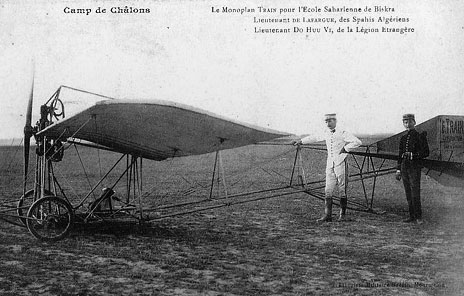
Les Ltt Henri de Lafargue et Tay Do-Hu-Vi posent à côté du monoplan Train destiné à l'école saharienne de Biskra, au camp de Châlons - Carte postale d'époque.
Le centre d'aviation militaire de Maubeuge :
L'escadrille Deperdussin D 4 de Maubeuge continue son entraînement. Tous les officiers réalisent de longues reconnaissances, le long de la frontière. Le 8 février, le Ltt Antonin Brocard, parti de Reims aux commandes d'un Deperdussin à moteur Gnôme de 80 ch, amenant un officier, est venu atterrir à Maubeuge. Le trajet a duré 1h17mn.
Réception d'un nouvel appareil pour Reims :
Devant la commision de l'armée, composée du Cne Destouches, du Cne Cammerman et de l'Adj Rémia, l'ingénieur L. Janoir a réceptionné un Deperdussin biplace à moteur Gnôme, destiné au centre d'aviation militaire de Reims, le 8 février. Le lendemain, Mrs. Clémentel, Cochery et Girod, membres de la commission parlementaire chargée d'étudier la situation de l'aviation militaire se sont rendus à l'aérodrome militaire de Reims. Ils ont passé en revue 40 avions presque tous équipés de moteurs Gnôme.
Le 16 février 1913, suite à la proposition du maire, le conseil municipal de la ville du Puy a décidé à l'unanimité de participer à la souscription ouverte dans la Meuse pour élever un monument en honneur du lieutenant aviateur Boncour, mort en service commandé, et de donner son nom à une rue de la ville. Boncour était originaire du Puy.
Le 16 février 1913, le Ltt Prat, pilotant un biplan à moteur Gnôme, effectue des tests de lancement de projectiles.
Le centre d'aviation militaire du Crotoy :
Le 26 février, le centre d'aviation militaire du Crotoy vient d'être inauguré et des vols ont été effectués par les pilotes du centre, le Ltt Gérard, chef du centre, le Ltt le Bihan et le soldat Jacquemart. Ils allèrent à Noyelles saluer le train spécial amenant les autorités civiles et militaires. Trois pilotes civils s'étaient joints aux aviateurs militaires. A son arrivée, les autorités assistèrent à l'amerrissage d'un nouvel hydravion piloté par René Caudron et destiné à l'armée chinoise.
Le centre d'aviation militaire de Maubeuge :
Le 1er mars, le Ltt Lalanne, sur Deperdussin biplace à Moteur Gnôme de 80 ch, a effectué, avec un passager, le trajet Maubeuge - La Fère - Douai - Maubeuge. Le Ltt Victor Radisson accompagné du Cne Monnier, a survolé la zone frontière sur un parcours de 80 km. Pendant ce temps, toujours à bord de Deperdussin biplaces à moteur Gnôme, le Sgt-Major Didier et le Sgt Verdié, tous les deux accompagnés d'un passager, ont effectués de nombreuses sorties dans un rayon de 50 km, pour initier à leur rôle les officiers observateurs.
Le terrain d'aviation de Buc :
A l'aérodrome Blériot de Buc, les officiers en formation pour passer le brevet de pilote s'entrainent aux tours de piste et aux atterrissages. Il s'agit du Capitaine Hervé, des lieutenants Taillepied de Bondy, Boucher, Dorsemaine, Biévin et Verdon. Le Sapeur Poulain, s'est joint au Sgt Brézillon, pour l'entraînement.
Mort du Ltt Raymond Porteau au camp d'Avord :
Le 1er mars, le Ltt Raymond Porteau, du 1er régiment d'infanterie coloniale, était détaché depuis un mois, au centre d'aviation militaire d'Avord. Il avait décollé en début d'après-midi pendant la visite de la commission parlementaire venue visiter l'aérodrome. Arrivé à 600 mètres d'altitude et volant en direction de Savigny-en-Septaine, l'appareil a piqué et s'est écrasé au sol. Il n'y avait plus rien à faire pour l'officier qui avait succombé d'une fracture du crâne et de la colonne vertébrale. C'est le premier accident mortel qui soit survenu à l'école d'aviation militaire d'Avord, laquelle fonctionne depuis un an. L'officier, âgé de 28 ans, était originaire de la Loire-Inférieure. Sorti de l'école militaire spéciale de St-Cyr, le 1er octobre 1907, il a été nommé lieutenant deux ans après. Il entra au service de l'aviation militaire, le 12 juin 1912 et avait obtenu son brevet de pilote, le 4 décembre 1912. Ses obséques seront célébrées à la chapelle du camp, le 3 mars. La levée du corps eut lieu à l'infirmerie transformée en chapelle ardente, sous l'autorité de Mgr Dubois, archevêque de Bourges.
Témoignage du Cne Bellenger à propos de cet accident : "Je ne me rappelle que d’un seul accident mortel, un lieutenant d’infanterie nommé Porteau. En 1913, le centre d’Avord ne fonctionnait qu’avec des moyens uniquement militaires. Au printemps 1913, c’était le seul centre dans ces conditions-là. La commission de l’armée à la chambre des députés a demandé au général Hirshauer des renseignements sur la formation du personnel. Il était du génie et moi de l’artillerie mais nous avions des rapports excellents. Il m’a envoyé la commission pour que je lui fournisse les explications demandées. Le jour où la commission est arrivée, un de mes élèves officiers, qui n’était pas très entrainé, a voulu se signaler. Les députés me disent qu’ils sont surtout intéressés par le fonctionnement administratif. Je les emmène dans mon bureau, il y avait M. Cochet président de la délégation. Porteau sort pendant ce temps l’appareil de son hangar, pour se faire admirer par les députés lorsqu’ils sortiraient du bureau. J’étais en train de discuter lorsqu’un sous-officier est venu me prévenir que le Lt Porteau venait de faire une chute sérieuse. Par la suite d’une fausse manoeuvre, il a atterri presque à la verticale… Il était mourant quand on l’a relevé. Je n’ai pas voulu signaler qu’il était en était de désobéissance car je n’avais pas donné d’ordres. Il a été porté tué en service commandé."
- Je cherche un portrait du Ltt Porteau -
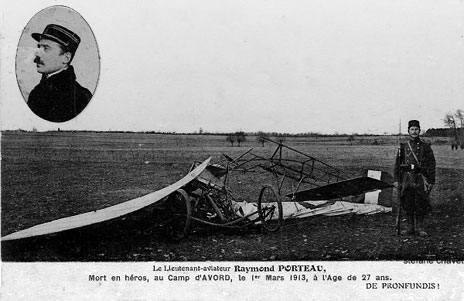
Epave de l'avion du Ltt Raymond Porteau tombé sur le camp d'Avord, le 1er mars 1913 - Carte postale d'époque.
L'aérodrome militaire de Bouthéon :
Le 2 mars, l'école forézienne d'aviation de Bouthéon est transformée en aérodrome militaire et dépendra du centre aéronuatique de Lyon-Ambérieu. Le Cne Carlin en prendra le commandement.
Raid de l'aviation militaire en Tunisie :
Les avions de la mission, qui avaient été dispersés par une tempête, ont pu reprendre leurs vols après 4 jours d'attente à Tunis, le 3 mars. Le MdL Hurard, parti le premier d'Enfidaville à 6h35 et a atterri sur l'hippodrome de Kassar-Saïd à 8h55. Il avait comme passager le Ltt Cheutin, dont l'appareil avait été endommagé lors de son atterrissage à Sousse. Un second biplan, piloté par le Ltt Reimbert, parti de Grombalia à 7h45, et ayant comme passager le sapeur mécanicien Dewouine, se pose à 9h05. Ils ont été félicités à leur atterrissage par les généraux Boyer et Bertin.
Le Ltt Jolain a quitté Bouficha vers 8h00. Gêné par un vent violent qui l'empêche de progresser, il pose son avion à Grombalia vers 9h00. Après avoir patienté quelques heures sur place, il a pu se poser sans encombre à Tunis à 16h25.
Le Ltt Reimbert, chef de l'escadrille, a l'intention de laisser les avions à Tunis pendant quelques jours pendant qu'il réalisera une reconnaissance en automobile au sud des forêts de Kroumirie. Si le voyage est possible par les airs dans de bonnes conditions, les avions rejoindront Constantine et Biskra par la voie des airs. Si ce n'est pas le cas, ils seront démontés et transportés à Constantine, où ils seront remontés. Ils pourront ensuite rejoindre Biskra.
Le service militaire va passer à 3 ans :
Le 4 mars 1913, le conseil supérieur de la Guerre s'est prononcé à l'unanimité pour un service militaire de 3 ans sans aucune dispense. C'est maintenant au gouvernement à prendre les décisions définitives qui seront proposées aux 2 chambres, car le conseil supérieur ne donne qu'un avis consultatif. Jusqu'à 1905, le service militaire était de 3 ans. Il est passé ensuite à 2 ans. Toutefois, la forte natalité de l'Allemagne lui permet de ne pas appeler sous les drapeaux tous les hommes valides. Elle peut donc augmenter le nombre de ses recrues quand elle veut. Cette nouvelle disposition permettrait de porter l'armée au-dela de 600.000 hommes. Le gouvernement s'efforcera de faire voter le projet de loi avant les vacances de Paques.
Raid de l'aviation militaire en Tunisie :
Le 9 mars, les avions engagés dans le raid Biskra-Tunis restent à Tunis quelques jours supplémentaires pour laisser le temps aux mécaniciens de procéder à plusieurs réparations. Le démontage des moteurs a été jugé nécessaire, à la suite de ratés constatés lors du dernier décollage, auquel avait prit part le colonel de Buyer, commandant le 4ème chasseurs d'Afrique. De plus, l'hélice de l'avion du MdL Hurard a été remplacée. Les lieutenants Lafargue et Reimbert sont chargés d'explorer la route de l'Algérie, par le Kef et la Kroumirie. Sauf imprévus, l'escadrille rentrera en Algérie par la voie des airs, avec étape au Kef. Dès que les réparations et la mise au point des appareils seront terminées, l'escadrille tentera le raid Bizerte et retour. Le Ltt Lafargue, chef de la station de Biskra, doit adresser au général Hirschauer, un rapport concernant la création d'une école d'hydravions, à Bizerte et une école d'aviation, à Tunis. La première aurait pour but l'exploration au large et la seconde la surveillance des côtes du Nord de la Tunisie.

Une superbe carte-photo présentant les principaux protagonistes du raid Biskra-Tunis de 1913 - MdL Hurard, Ltt Reimbert, Ltt Cheutin, Ltt Jolain et le sapeur mécanicien Dewotine, expéditeur de cette carte - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo collection Patrice Vachée que je remercie pour son aide.
Crédits pour l'institut aérotechnique de Saint-Cyr :
Le parlement a accordé à l'université de Paris, un crédit à affecter aux installations de l'institut aérotechnique de Saint-Cyr. Il a été décidé la construction :
- d'une batterie dynamométrique permettant d'étudier, sur l'un des chariots électriques de l'institut, les propriétés aérodynamiques des avions entiers.
- d'un appareillage électrique permettant d'effectuer, au manège rotatif de l'institut, des expériences de modèles et d'hélices à différentes vitesses.
- l'installation d'un puissant dispositif à courant d'air, en circuit fermé, dans lequel l'essai des modèles réduits fixes pourra être effectué jusqu'à une vitesse du courant d'air dépassant 140 km/h.
Les deux premières de ces installations seront présentées à la commission sénatoriale d'aviation, au cours de la visite qu'elle se propose de faire à l'institut en compagnie du général Hirschauer. La commission examinera les chariots électriques en service pour l'étude en vitesse des hélices d'aviation et les appareils enregistreurs employés en vol dans les avions.
L'escadrille Deperdussin du Maroc :
Le 12 mars, stationné au camp de Nérada, sur les bord de la Moulouya (Maroc), les lieutenants Jannerod et Magnien ont reçus l'ordre, par dépêche, de rejoindre leur chef par la voie des airs. Ils décollèrent aux commandes de Deperdussin biplaces et réalisèrent cette mission en une heure, à l'altitude de 800 mètres.
Le comité national pour l'aviation militaire :
Les fonds de la souscription nationale organisée par le syndicat de la presse a recueilli jusqu'ici près de 4.000.000 de francs. Sur ce total, 2,623.884 fr ont été versés au comité et 1.324.280 fr directement au trésor public.
Les fonds recueillis auront permis l'acquisition de 170 avions en dehors de ceux prévus au budget. Sur ces avions, 67 ont été mis en service en 1912, les autres suivront au cours de l'année 1913. De plus, 40.178 fr ont été versés pour les recherches des moyens d'obtenir la sécurité en avion et 6.160 fr pour l'aviation maritime.
Ce fut d'abord la création de nombreux terrains d'atterrissage indispensables à l'aviation militaire. Trente-deux stations d'atterrissages sont actuellement en voie d'exécution et seront bientôt achevées. Ce sont celles d'Avesnes, Biarritz, Brienne-le-Château, Chambéry, Châtillon-sur-Seine, Chaumont, Commercy, Coulommiers, Dôle, Evreux, Gray, Joigny, Langres, Longwy, Lunéville, Meaux, Neufchâteau, Pont-à-Mousson, Remiremont, Rethel, Saint-Dié, Saint-Dizier, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Quentin, Sézanne, Soissons, Troyes, Valenciennes, Vesoul, Vienne, Vitry-le-François, Vouziers.
Vingt-cinq autres stations seront très prochainement créées à Saint-Omer, Chauny ou Laon, Vervins, Château-Thierry ou Montmirail, Provins, Montmédy, Sainte-Ménéhould, Briey, Semur, Beaune, Mâcon, Montargis, Cosne, Nevers, Roanne, Lons-le-Saulnier, Besançon, Vendôme, Tours, Angoulême, Mont-de-Marsan, Limoges, Périgueux, Marmande.
La dernière mission du comité national sera l'organisation d'écoles de préparation militaire pour le pilotage des avions. L'armée a besoin de recevoir, chaque année, un grand nombre de jeunes conscrits ayant déjà obtenu leur brevet de pilotage, à qui des appareils peuvent être immédiatement confiés. Assurer à l'armée, le recrutement de pilotes déjà formés, est certainement la mission la plus utile à laquelle une oeuvre d'initiative privée puisse de consacrer. Le comité national a pu, jusqu'ici, prélever une somme suffisante pour assurer l'éducation technique de 76 hommes qui deviendront bientôt d'excellents pilotes militaires.
Les sous-officiers de l'aéronautique :
Aux termes d'un nouveau décret, les sous-officiers de l'aéronautique militaire provenant des militaires incorporés dans l'aéronautique pourront être admis à concourir, soit pour Saint-Maixent, soit pour Versailles (école militaire du génie).
Mangin bat les Zaïans à Botmat-Aïssaoua :
Le 26 mars 1913, au Tadla, le colonel Mangin, avec deux colonnes, bat les Zaïans à Botmat-Aïssaoua. Khenifra sera occupée en juin, par trois colonnes convergentes. Toute l'année, des violents combats opposeront les coloniaux et les guerriers berbères. L'ensemble de ces opérations, très dures et coûteuses, aura pour effet de délivrer les tribus du Tadla de l'emprise des montagnards Chleuhs et Zaïans.

Le colonel Mangin assiste au départ en mission du Ltt des Prez de La Morlay pour une reconnaissance sur le Tadla - Carte postale d'époque.
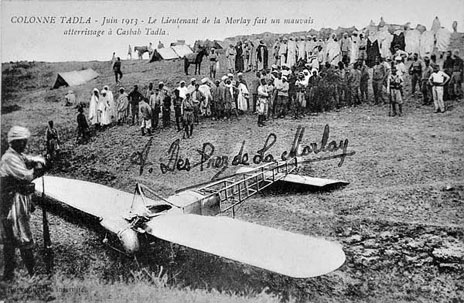
Accident du Blériot n° 125 piloté par le Ltt Armand des Prez de la Morlay près de la Casbah Tadla, en juin 1913 - Le pilote n'a pas été blessé mais l'avion a été jugé irréparable - Carte postale d'époque qui porte l'autographe du pilote.
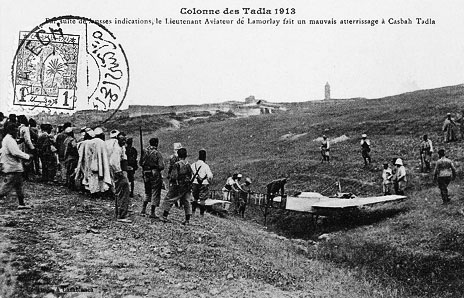
Autre vue du Blériot n° 125 piloté par le Ltt Armand des Prez de la Morlay accidenté près de la Casbah Tadla, en juin 1913 - Carte postale d'époque.

Autre photo du Blériot n° 125 du Ltt Armand des Prez de la Morlay tombé en contrebas du terrain d'atterrissage près de la Casbah Tadla, en juin 1913 - Le pilote est sauf - On aperçoit nettement le nom de baptème de cet avion "Madagascar" qui a été offert aux armées par le comité de souscription de Madagascar à l'occasion de la souscrition nationale - Carte postale d'époque.
Mort du Ltt René Bresson :
Le Ltt René Bresson, du 7ème régiment d'infanterie coloniale, affecté au terrain d'aviation de Reims, est venu à Verdun pour participer à la manoeuvre de garnison ordonnée par le général commandant le 6ème coprs d'armée. Le 28 mars 1913, il décolle du terrain de Chamois, normalement occupé par l'escadrille de Verdun, pour rejoindre Nancy. Alors qu'il volait à une altitude de 800 mètres, une détonation se fit entendre et son avion, après avoir piqué du nez, s'écrasa au sol. L'officier a été tué sur le coup par un coup très violent au crâne. Son corps a été transpotré à l'hôpital Saint-Nicolas de Verdun.
Lancement de projectiles :
Le 29 mars, le Ltt Victor Radisson, avec un sapeur comme passager, a effectué le trajet Maubeuge - La Fère - Douai - Maubeuge, soit 250 km, à bord d'un Deperdussin biplace équipé d'un moteur Gnôme de 80 ch. De son côté, le Ltt Ulysse Lalanne, aux commandes d'un Deperdussin à moteur de 50 ch, a placé 6 bombes dans une cible de 50 mètres de rayon. Le général de division Desaleux, gouverneur militaire de Maubeuge, a assité à ces essais de bombardement aérien.
L'escadrille Deperdussin du Maroc :
En fin mars, les lieutenants Jannerod, en monoplace, et Magnien, en biplace, ont réussi leurs reconnaissances sur les hauts plateaux. Ils ont volé sur Berguent et sont rentrés à Oujda, après un voyage de près de 200 km. La grosse difficulté consistait à franchir les barrières montagneuses formées par le massif du Djebel-Ketoum, dont les sommets atteingnent 1.600 mètres. Les deux officiers, qui ont été obligés de voler haut, ont souffert du froid. Le passager du Ltt Magnien a pu prendre plusieurs clichés. Ces missions portent à 2.000 km la distance parcourue en reconnaissances par l'escadrille Deperdussin du Maroc Oriental, unité formée il y a deux mois.

Départ d'un des Deperdussin de l'escadrille du Maroc en 1913 - Carte postale d'époque.

Essai moteur d'un Deperdussin de l'escadrille du Maroc en 1913 - Carte postale d'époque.
Mort de l'Adj Jean-Louis Faure :
Le 2 avril, l'Adj Jean-Louis Faure, du 12ème régiment d'artillerie et détaché comme élève pilote à l'école d'aviation de Buc, passait l'examen pour l'obtention du brevet militaire, sur le terrain de Toussus-le-Noble. Au bout d'une heure de vol, son biplan, qui était alors à 100 mètres d'altitude, se mit à tanguer et vint s'écraser devant les hangars du terrain. Malheureusement, le sous-officier a été tué sur le coup par le bloc moteur qui l'avait presque coupé en deux.
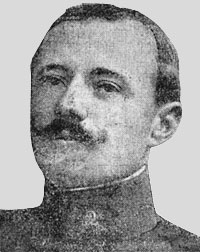
Adj Jean-Louis Faure - Né le 19 juin 1877 à Arcachon (Gironde) - Fils de Jean Faure et de Jeanne Cazaux - Marié avec Marie Emilienne Duhar - Domiciliés 13, rue de Berry à Bordeaux (Gironde) - Issu du 12ème régiment d'artillerie - Brevet de l'Aéroclub de France n° 1231 obtenu le 7 mars 1913 - Détaché à l'école d'aviation de Buc - Tué au cours d'un accident aérien à Toussus-le-Noble, le 2 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France et acte de décès transmis par Frédéric Domblidés que je remercie pour son aide.
Mort du MdL Henri Chanroux :
Le 2 avril, deux avions, arrivant du centre d'aviation militaire de Reims, venaient atterrir sur l'aérodrome d'Amiens. Le premier appareil, piloté par le Ltt Aretto, s'est posé normalement. Le MdL Henri Chanroux, qui pilotait le second, se présenta à une hauteur de 4 à 5 mètres d'altitude pour se poser devant les hangars. C'est à cet instant, qu'une des ailes a touché le sol et que l'avion a capoté. Le pilote, projeté en l'air, s'écrasa lourdement au sol et fut tué sur le coup. Les médecins trouvèrent sur sa dépouille mortelle les fractures du crâne et des deux jambes. Ce sous-officier, né le 8 juin 1887 à Corbeil, était marié. Le 6 avril, il a été mis en terre dans sa ville natale après une cérémonie présidée par Mgr Gibier, évêque de Versailles.

MdL Henri Chanroux - Né le 8 juin 1887 à Corbeil - Pilote du centre d'aviation militaire de Reims - Tué au cours d'un accident aérien sur le terrain d'Amiens, le 2 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
Le 3 avril, un biplan militaire piloté par le Ltt Mauger-Devarennes, avec le Cne Halter, du 162ème régiment d'infanterie comme passager, a atterri à Longwy venant de Verdun. Il a regagné son centre, le soir même. Le Cne Aubry, du centre de Reims, a quitté sur un monoplan, Longwy, où il était depuis 15 jours. Il a fait le trajet de Longwy à Reims en 1h15.
Le même jour, le caporal Robert Deloche du centre d'aviation du Crotoy et pilotant un biplan, a décollé pour joindre Calais dans le cadre de l'épreuve du brevet militaire de pilotage. En route, le moteur de son appareil est victime de ratés et il doit se poser dans un champ à Ostrohove, près de Boulogne-sur-Mer. Au cours de l'atterrissage, l'aile gauche touche un talus et est endommagée. L'aviateur est indemne.
Le 7 avril, les lieutenants Grezaud et Gignoux, accompagnés des sapeurs David et Manie, ont décollé d'Epinal à destination de Lyon. Ce sont ces deux officiers qui survolèrent le Zeppelin à Lunéville. En route, ils ont fait escale successivement à Chalons-sur-Marne, puis Tournus. Le lendemain matin, ils sont finalement arrivés à Lyon-Bron. Le Cne Plantier a quitté Lyon-Bron pour Beaune aux commandes d'un monoplan.
Le terrain d'aviation de Buc :
Le 14 avril, sur l'aérodrome Blériot de Buc, les pilotes Edmond Perreyon et John Domenjoz ont effectués les essais de réception de 7 nouveaux appareils militaires. Ces avions s'ajoutent à 8 précédemment pris en compte par les armées. Ces tests ont été fait devant la commission militaire présidée par le Cne Destouches.
Le dirigeable rigide Spiess :
Le 14 avril, le dirigeable à armature rigide "Spiess" conçu par la firme "Zodiac" a été sorti de son hangar, sur le terrain du 1er groupe d'aérostation à Saint-Cyr-l'Ecole. Il est alors le plus long dirigeable français de l'avant guerre 14-18 avec une longueur de 113 mètres pour un diamètre de 41,2 m. Le but de ces essais, pour le concepteur, M. Joseph Spiess, étant de tester au sol le bon fonctionnement des deux moteurs de 140 ch. Il faut préciser que la structure interne de ce dirigeable est constituée d'armature en bois creux à section carrée contrairement aux "Zeppelin" qui est constitué d'aluminium. Il est prévu que le "Spiess" effectue sa première sortie très prochainement.
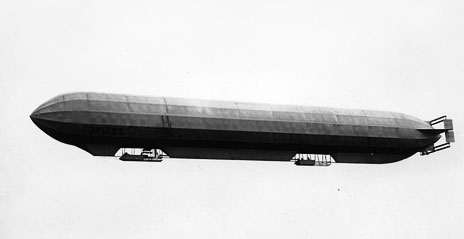
Photo du dirigeable "Spiess" en vol en 1913 - Elle ne montre pas son état initial mais après agrandissement et changement des moteurs - Carte postale d'époque.
Le 14 avril, un avion, piloté par le Ltt Léon Mercier qui passait une épreuve du brevet de pilote militaire, a été victime de ratés de moteur et s'est écrasé près de Montcornet. Malgré une descente de plus de 400 mètres et la destruction totale de l'appareil, l'aviateur militaire s'en est tiré sans la moindre égratignure. Il a finalement obtenu le brevet de pilote militaire n° 253, le 24 avril 1913.
L'accident du ballon "Zodiac XIV " :
Depuis près de 2 mois, les aviateurs militaires effectuent des exercices de reconnaissances aériennes, à bord de ballons sphériques pilotés par des officiers aérostiers. Les départs de ces ballons ont lieu dans l'enceinte du parc aérostatique de l'Aéroclub, à Saint-Cloud.
Le 17 avril, cinq départs sont prévus. La météo n'est pas très bonne avec un vent assez violent et la pluie qui tombe en rafales.
Pour la 4ème mission, le ballon sphérique de type "Zodiac XIV" de 1.600 m3 s'élève et prend rapidement de l'altitude. Son équipage se compose de :
- M. Jacques Aumont-Thiéville, pilote de la mission, aérotier civil de l'Aéroclub de France et auteur d'une traversée nocturne de la Manche, seul à bord du ballon "la Tulipe", le 28 septembre 1912.
- Capitaine Pierre Clavenad, aviateur militaire, brevet de pilote militaire n° 9 obtenu le 6 mai 1911, issu des chasseurs à pied,
- Capitaine Henri de Noue, aérostier militaire du parc aérostatique militaire de la Maison-Blanche de Vincennes, issu du 3ème régiment de Dragons de Nantes,
- Lieutenant de vaisseau Hilaire de Vasselot de Regne, aviateur militaire, issu du régiment de génie de Versailles,
- Sergent Henri Richy, élève pilote militaire du centre d'aviation de Douai.

Cne Pierre Clavenad - Pilote militaire - Issu des chasseurs à pied - Brevet de pilote militaire n° 9 obtenu le 6 mai 1911 - Tué au cours de l'accident du Zodiac XIV, le 17 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
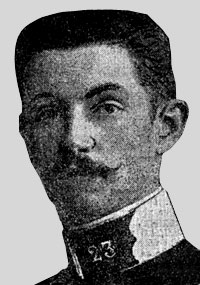
Cne Henri de Noue - Issu du 3ème régiment de Dragons de Nantes - Aérostier militaire du parc aérostatique militaire de la Maison-Blanche de Vincennes - Tué au cours de l'accident du Zodiac XIV, le 17 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

LV Hilaire de Vasselot de Regne - Issu du régiment de génie de Versailles - Aviateur militaire - Tué au cours de l'accident du Zodiac XIV, le 17 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

Sgt Henri Richy - Elève pilote du centre d'aviation de Douai - Brevet de pilote militaire n° 241 obtenu le 2 avril 1913 - Tué au cours de l'accident du Zodiac XIV, le 17 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
Après avoir survolé Paris à une grande altitude, le ballon, qui donnait des signes de défaillance depuis Vincennes, était brusquement descendu et avait en partie arraché les fils télégraphiques et les signaux de la voie ferrée près de Rosny-sous-Bois. Poussé par un vent violent d'Ouest, le ballon frôle la cime des arbres près de Nogent. A Fontenay-sous-Bois, l'équipage largue du lest pour regagner de l'altitude. En vain ! La bourrasque le plaque au sol. Au passage, le ballon emporte une cheminée. Après un nouveau lancé de lest et le largage de l'ancre, le ballon reprend un peu de la hauteur. Arrivé à 250 m d'altitude, entre la Malhoue et Noisy-le-Grand, le Zodiac se dégonfle brusquement, se replie sur lui-même et s'écrase au sol dans un champ labouré appartenant au comte de Cahen d'Anvers, entre Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne.
Les témoins, arrivés sur place, découvrent une scéne tragique. Les cinq occupants de la nacelle gisent au sol, enchevétrès les uns sur les autres. Le Cne Clavenad, le Sgt Richy et M. Aumont-Thiéville avaient été tués sur le coup. Les deux derniers occupants, qui avaient tenté de monter dans les cordages pour se protéger de la chute, étaient encore en vie. Les deux officiers, grièvement blessés, sont chargés dans une automobile arrivée sur place. Déposés dans une salle de billard d'un café voisin de la gare de Villiers-sur-Marne, ils reçoivent les premiers soins de deux médecins. Ils constatèrent très vite que l'état de santé du Cne de Noue était critique car il souffrait d'une fracture de la colone vertèbrale. Il décédera des suites de ses blessures. Le dernier blessé, le Ltt de Vasselot semble moins atteint car il était toujours conscient. Il est transporté, par ambulance militaire, à l'hôpital Bégin, où il décédera des suites de ses blessures internes, quelques heures plus tard.
L'enquête va montrer que la corde de déchirure avait été volontairement tirée, ouvrant normalement sur plus de 30 cm le panneau de déchirure situé au sommet de l'enveloppe. Cette manoeuvre se fait normalement à un mètre de sol, juste avant l'atterrissage. La corde de déchirure est enveloppée d'une large bande d'étoffe rouge qui la distingue nettement de toutes les autres commandes. La traction de cette corde en altitude provoque la chute certaine du ballon.
Les hypothèses avancées auront été que le pilote a dû demander de l'aide à ses passagers pour maitriser son engin à travers les rafales de vent. Non expérimentés, l'un d'eux a dû commettre une fausse manoeuvre dans le maniement des cordes de commandes, provoquant la chute fatale de l'aérostat.
Accident d'avion au camp de Mailly :
Le 20 avril, un biplan affecté au camp de Mailly, piloté
par le caporal Fouquet est parti en perte de vitesse dans un virage et s'est écrasé dans un bosquet de sapins. Le pilote et son passager, un sergent au service de l'aéronautique, ont été retrouvés évanouis et ont été évacués sur l'infirmerie du camp.
Mort du Ltt René de Blanmont :
Le 21 avril, le Ltt René de Blanmont, issu du 7ème régiment d'infanterie coloniale, décolle de Villacoublay. Après une heure de vol, il revient au terrain et se présente en vol plané pour atterrir. A cet instant, un violent coup de vent survint, mêlé de pluie.
Plusieurs fois, l'aviateur redresse son appareil mais soudain, les ailes se replièrent contre le fuselage, sans doute consécutif à une rupture de haubans. Le monoplan tomba d'une hauteur de 250 mètres et s'écrasa derrière les hangars Breguet.
Le lieutenant, qui n'avait pas attaché sa ceinture, fut précipité dans le vide et tomba à 30 mètres de son appareil.
Très grièvement blessé avec des fractures au crâne, aux deux bras et à la jambe gauche, il expira très rapidement.
Ses obséques ont été célébrées à l'hôpital militaire de Versailles, le 24 avril. Le dernier adieu a été prononcé par le Cne Guyabert, commandant du centre d'aviation de Villacoublay. Il a ensuite été inhumé à Asnières.

Ltt René de Blanmont - Né le 27 avril 1887 - 7ème régiment d'infanterie coloniale - Trois années de service en Cochinchine - Avait passé les 2 premières épreuves du brevet de pilote de l'Aéroclub de France - Ce brevet devait lui être accordé le 21 avril, jour de son décès - Tué au cours d'un accident aérien à Villacoublay, le 21 avril 1913 - Photo "Le Matin " mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
Un avion militaire posé par erreur en Suisse :
Un avion militaire français, piloté par le Ltt Edmond Louis Gaubert, s'est posé par erreur sur le plateau de Wavre, près de Neuchâtel (Suisse). Parti d'Is (Ht-Marne), et après avoir fait escale à Dijon, il devait se poser à Belfort. Cependant, complétement perdu dans les nuages, il passa au-dessus des trois lacs suisses de Morat, Bienne et Neufchatel pour se poser à Wavre. Après avoir démonté son appareil, il est reparti par chemin de fer.
Un avion allemand se pose par erreur à Arracourt :
Le 22 avril, quatre biplans
allemands et un Zeppelin avaient décollé de Darmstadt pour rejoindre le terrain de Metz-Frescaty.
L'un des avions, en panne d'essence, se pose à Arracourt, près de Lunéville (54).
Son équipage était composé du Htm Devall, chef de la section aérienne de Darmstadt et du Ltn von Mirbach du régiment d'infanterie n° 31.
Ces hommes se sont mépris sur leur destination en raison d'une légère brume qui couvrait la région.
Après avoir interrogé les deux officiers allemands et conscient de leur bonne foi, les autorités militaires les ont autorisé à refaire le plein et à continuer leur route vers Metz.
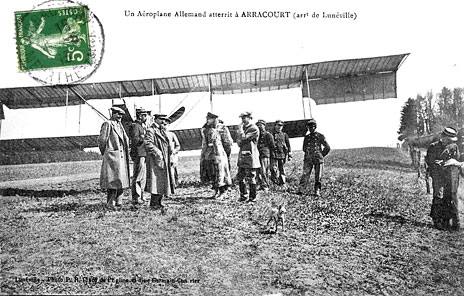

Le biplan allemand posé par erreur près d'Arracourt (54), le 22 avril 1913 - Cartes postales d'époque.
Le général Warin en avion :
Le 23 avril, le général de cavalerie Warin, commandant la brigade de Dragons de Lunéville, est parti pour Nancy, à bord d'un biplan piloté par le caporal Mahieu. Arrivé au-dessus du plateau du Vermois, le caporal se rend compte que le moteur ne fonctionne pas normalement et cogne. Il le coupe immédiatement et descendit en vol plané jusqu'à la côte de Tarbes, sur la commune de Ville-en-Vermois. La culasse d'un des cylindres était fêlée. Le général termina sa route à cheval et le caporal Mahieu par la voie des airs, le lendemain.
L'escadrille Blériot du Maroc Occidental :
Le 25 avril, le comte de Lareinty-Tholozan, qui effectue une période de réserve dans l'aéronautique, a demandé de la faire dans l'escadrille Blériot du Maroc Occidental. Actuellement à Marrakech, il a emmené comme passager le Caïd pacha de Marrakech Hadj Thami Glaoui, puis le caïd Bouhaid Doukkali.
Ltt Antonin Brocard, recordman du monde d'altitude avec 2 passagers :
Le 28 avril, le Ltt Antonin Brocard, du centre d'aviation de Reims, a battu le record du monde de hauteur avec 2 passagers à bord d'un monoplan Deperdussin triplace. Il a atteint l'altitude de 2300 mètres en 1h35mn. Ses passagers étaient le caporal Henriot (mécanicien) et le sapeur Chapat.
L'escadrille du Maroc Occidental :
Le 29 avril, la section d'aviation de Casablanca a couvert 1.300 km en moins de 8 jours, malgré la mauvaise saison qui couvre le Maroc de violents orages et de pluies coupées par des coups de chaleur torride. Parmi ses missions, nous pouvons citer :
- le Ltt Armand des Prez de la Morlais, aux commandes de l'avion biplace en tandem, le "Madagascar", offert par cette colonie à l'armée. Chargé du courrier de la colonne Mangin, il a effectué la liaison Casablanca - Oued-Zem et retour (200 km), puis la liaison Casablanca-Marrakech et retour (400 km).
- le Comte Jules de Lareinty-Tholozan, comme officier de réserve, est allé de Casablanca à la Kasbah-Ben-Admed et retour (160 km), Casablanca-Marrakech (200 km) et a rejoint la colonne mangin à El-Borouj (150 km).
- le MdL Marcel Feierstein a lui aussi fait une liaison courrier avec la colonne Mangin, soit Casablanca-El-Borouj (150 km).
- Le Cne Jacques Balsan (réserve) est arrivé à Casablanca, le 20 avril.
Pour l'instant, tous les avions sont en parfait de marche. La section sera bientôt dotée de Blériot type 1913.
Atterrissage en campagne :
Le 30 avril, reliant Amiens à Rouen, le Cne Jules Aubry a été pris dans un orage. Il a été contraint d'atterrir en catastrophe dans les environs de Formerie. Son monoplan a été endommagé mais le pilote est indemne.
Grave accident à Constantine :
Le 30 avril, les aviateurs militaires réalisaient des démonstrations de vol au-dessus de l'hippodrome de Constantine. Après deux vols effectués par l'équipage Ltt Ernest Reimbert / Ltt Cheutin, l'équipage Ltt Joseph Jolain / Ltt de Mondésir du 3ème régiment de chasseurs décolle. Arrivé à une altitude de 25 m, au moment de virer, l'avion est pris dans des remous. Il occile et s'écrase brusquement. Les aviateurs sont relevés en sang avec plusieurs fractures et des contusions multiples. L'état du Ltt Jolain est celui qui inspire le plus d'inquiétude avec plusieurs fractures aux jambes. Ils ont tous les deux été évacués sur l'hopital militaire de la ville.
Le Ltt Jolain, qui restera handicapé après son grave accident aux jambes, sera fait chevalier de la Légion d'Honneur par le général Leguay, pour sa participation au raid sur Toughourt-Biskra-Constantine, le 2 août 1913.
Un terrain d'aviation à Tours :
Le 30 avril, M. F. Boudet, délégué de la Ligue Nationale Aérienne, avait le projet de créer un terrain d'aviation sur le terrain de manoeuvres du Menneton. MM. Zirnheld et le Cne Charles Marconnet, délégués du Comité National de l'aviation militaire, s'y sont rendus. Ce terrain a été reconnu parfaitement utilisable. L'escadrille du Ltt Maurice Précardin et du Ltt Fernand Campagne y a déjà atterri plusieurs fois. Des travaux d'aménagement vont être effectués et un hangar sera construit en bordure du champ, sur une partie exhaussée et à l'abri des crues du Cher.
Les hydravions aux manoeuvres navales :
Le 1er mai, le ministre de la Marine a exprimé le désir de voir particpier le plus grand nombre possible d'hydravions pendant les manoeuvres navales, qui commenceront le 10 mai par le blocus du port de Toulon. Le capitaine de Vaisseau Fatou, commandant supérieur de l'aviation maritime va étudier, avec l'aide d'une commission spéciale, le stationnement de ces appareils que possède la marine. Ce sera la première fois que des hydravions opéreront pendant des manoeuvres navales et participeront à la défense des côtes.
L'escadrille du Maroc à Batna :
Le 1er mai, l'escadrille des biplans militaires (HF 20) pilotés par les lieutenants Ernest Reimbert, Cheutin et le MdL Hurard, est arrivée à Batna (Algérie). Ils ont effectué le parcours reliant Constantitne à Batna en volant au-dessus de Lambèse et Timgad. Ils ont été chaleureusement reçus par la municipalité de Batna, ainsi que par les officiers en poste. En outre, on annonce que l'état des lieutenants Jolain et de Mondésir, accidentés hier à Constantine, est maintenant très satisfaisant.
Epreuve du brevet de pilote militaire pour le sapeur Poulet :
Le 2 mai, le sapeur Poulet, de la station d'aviation militaire du Crotoy, a accompli, dans le cadre de la dernière épreuve visant à l'obtention du brevet de pilote militaire, le trajet Beauvais - Boulogne-sur-Mer - Le-Crotoy - Beauvais.
Manoeuvres des cadres à Auxerre :
Le 2 mai, trois biplans militaires, partis de Buc et pilotés par le Ltt Gironne, MdL Carus et le Cprl Frank, se sont posés à Auxerre. Ces aviateurs participeront aux manoeuvres de cadres qui vont commencer dans la région, sous la direction du général Joffre. Dix-sept cents territoriaux sont arrivés, le même jour et campent sur le terrain de manoeuvres de garnison, faute de locaux disponibles.
Le dirigeable "Selle-de-Beauchamps" a rejoint Châlons-sur-Marne :
Le 2 mai, le dirigeable militaire "Selle-de-Beauchamp" est parti de Moisson à 7h20, via Lamotte-Breuil, pour rejoindre Châlons-sur-Marne, son port d'attache. Le dirigeable a évolué sur Reims et est arrivé à 10 h pour s'amarrer devant le hangar militaire de Mourmelon-le-Petit, près de Châlons-sur-Marne. L'équipage, entièrement militaire, était composé des capitaines Bois et Balensi, du Ltt Frugier et de 3 mécaniciens.
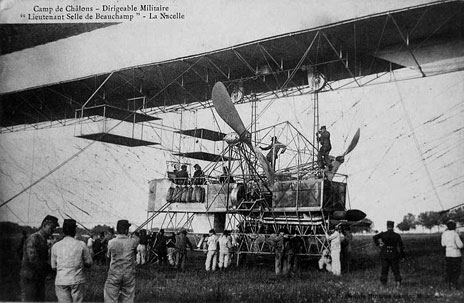
Vue de la nacelle du dirigeable "Selle-de-Beauchamp" sur le camp de Mourmelon-le-Petit pendant l'été 1913 - Carte postale d'époque.
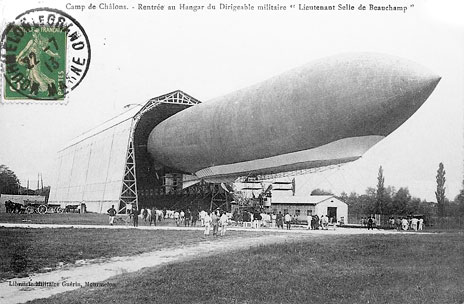
Rentrée du dirigeable "Selle-de-Beauchamp" dans son hangar du Camp de Mourmelon-le-Petit (près de Châlons-sur-Marne) pendant l'été 1913 - Carte postale d'époque.

Camp de Moumelon-le-Petit - Vue du hangar abritant le dirigeable en service dans ce camp d'entrainement - Carte postale d'époque.
Mort du Sgt Louis Battini à Saint-Cyr-l'Ecole :
Le Sgt Louis Battini, du 86ème régiment d'infanterie et détaché à l'aérodrome de Mourmelon, s'entraînait depuis plusieurs jours au-dessus de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole en vue d'obtenir son brevet de pilote militaire. Il était titulaire du brevet de pilote de l'Aéroclub de France (n° 1263). Le 4 mai, profitant d'une très belle journée sans vent, il avait décollé, aux commandes d'un biplan, pour plusieurs heures de vol au-dessus de Villepreux, de Bois-d'Arcy, du camp de Satory et de Saint-Cyr. A 9h00, un vent violent s'était levé, il avait atterri près de Bois-d'Arcy. A 10h, il était reparti pour Saint-Cyr. Malgré l'augmentation de la vitesse du vent, il redécolla pour un dernier vol. Après avoir viré sur Fontenay-le-Fleury, et passant au-dessus de la ferme de la Maison-Blanche, l'avion fut pris dans des remous. Malgré plusieurs tentatives de son pilote, l'appareil tomba d'une altitude de 150 mètres et s'écrasa. Il était seulement à 1500 mètres du terrain.
Le sapeur Guillien (aérostier) arriva le premier sur le lieu de l'accident. Il n'y avait plus rien à faire pour le Sgt Battini qui avait succombé d'une double fracture du crâne. Le corps de l'infortuné aviateur fut transporté à l'hôpital militaire de Versailles. Louis Battini avait 25 ans.
Le 6 mai, le Cne Etevé, commandant du centre d'aviation de Saint-Cyr prononca son éloge funébre puis son corps fut dirigé sur Saint-André-de-Bozzio (Corse) d'où sa famille est originaire.

Sgt Louis Battini - 86ème régiment d'infanterie - Brevet de l'Aéroclub de France n° 1263 - Brevet de pilote militaire n° 32 en date du 18 août 1911 - Détaché à l'aérodrome de Mourmelon - Tué au cours d'un accident aérien, le 4 mai 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
La seconde sortie du dirigeable "Spiess" annulée :
Le 3 mai, le dirigeable "Spiess", le plus grand des dirigeable français avec 114 m de longueur, n'a pu effectuer sa seconde sortie à partir du terrain de Saint-Cyr-l'Ecole. Avant de sortir l'appareil de son hangar, le moteur fut lancé pour s'assurer de son fonctionnement. Au bout de quelques minutes, un retour de flammes causa une forte détonation et un panache de fumée important. Sans attendre, l'un des aérostiers s'empara d'un sac de lest et couvrit le moteur de sable pour circonscrire l'incendie qui menacait. Tout danger était écarté mais le sable s'étant infiltré dans le carter et dans le mécanisme du moteur, tout vol était maintenant impossible.
L'escadrille de Poitiers :
Le 4 mai, les 5 pilotes (4 officiers et un sergent) actuellement détachés à Poitiers pour effectuer des exercices de lancement de bombes, ont reçu l'ordre de regagner le centre de Versailles. Ils vont participer, avec beaucoup d'autres unités aériennes, à la présentation militaire qui sera faite à l'occasion de la visite du roi d'Espagne, à Villacoublay.
La réserve dans l'aéronautique militaire :
Cette année, 270 réservistes appartenant à d'autres armées, seront incorposés dans le corps des aviateurs pour y effectuer une période d'instruction de 4 semaines. Trente seront instruits comme aviateurs, les autres comme mécaniciens.
Accident à Reims :
Le 7 mai, alors qu'une commision passait en revue des appareils et du matériel, plusieurs aviateurs évoluaient au-dessus du terrain. Parmi eux, le Ltt René Simon, accompagné du sapeur Amyot, enchainait une belle série de virages à seulement 50 m d'altitude. Soudain, on vit le monoplan tanguer, glisser sur l'aile, tomber en perte de vitesse et finalement s'écraser.
Le Ltt Simon souffrait du nez cassé, d'une jambe fracturée et de contusions multiples. Le Sapeur Amyot a été plus gravement touché avec les bras brisés, les jambes fracturés et plusieurs côtes enfoncées. Ils ont été évacués vers une clinique de Reims.
L'aviateur Simon a fait un stage d'un an à l'aérodrome militaire de Reims et participa aux principaux meetings d'aviation en 1910. Il fit de nombreux voyages avec Audemars et Roland Garros en 1911 et 1912, en Amérique. Il fut détenteur de la Coupe Michelin, au Havre, en 1910.
Au même moment, le dirigeable "Selle de Beauchamp" évoluait au-dessus du terrain, à une altitude de 300 mètres, avant de regagner son port d'attache du camp de Mourmelon.

Ltt René Simon, victime d'un accident d'aviation, le 7 mai 1913 - Brevet de pilote militaire n° 199 en date du 21 janvier 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
Accident sur le terrain d'Aulnoye-lez-Valenciennes :
Un biplan s'est écrasé en atterrissant sur le terrain d'Aulnoye-lez-Valenciennes, le 7 mai. Le sapeur Georges Defourgère (pilote) et le caporal Emile Strohl (passager) ont été légèrement blessés.
Présentation au roi d'Espagne :
Le 10 mai, de nombreux avions se sont envolés devant le roi d'Espagne en visite sur le terrain de Buc. Parmi eux, le MdL Robert Damberville a décollé à destination de l'aérodrome du Madrillet de Rouen, sa ville natale. C'est lui qui inaugurera ce terrain par sa prestation aérienne. Le Ltt Brocas qui représentait le centre militaire de Reims est rentré sans incident, en compagnie de son mécanicien.
Un monument en hommage au Ltt Caumont de la Force :
Le 16 mai, le comité s'est constitué en vue d'ériger un monument à la mémoire du Ltt Jacques Nompar de Caumont-la-Force, tué en service aérien à Buc, le 30 décembre 1910. Le monument sera élevé à Lunéville, ancienne garnison du lieutenant, en bordure du champ de manoeuvre, non loin de l'endroit où il atterrit en août 1910.
De Belfort à Dijon :
Le 16 mai, le Ltt Jacques de Sylvestre (artillerie), aux commandes d'un biplan, a atterri à la Maladière en provenance de Belfort. Il a été reçu par les officiers du 48ème régiment d'artillerie au quartier Junot tandis que son avion a été abrité dans le hangar militaire. Le lendemain, il a observé les manoeuvres de la 30ème brigade d'infanterie et consigné ses observations sur papier. Il a ensuite largué un tube-message contenant ces renseignements sur l'état-major de l'exercice.
Les trains de Cerfs-volants aux manoeuvres navales :
Le Cne Jacques Saconnet et le Ltt Chollet, accompagnés d'une équipe d'aérostiers et de leur matériel de trains de cerfs-volants, doivent participer aux prochaines manoeuvres navales. Le 16 mai, ils viennent d'effectuer une série de tests préliminaires à bord du croiseur cuirassé "Edgar-Quinet" dans les parages des îles d'Hyères. Ils collaboreront, le 19 et 20 mai, au service de renseignements et d'observation pour le forcement du blocus du port de Toulon (le but des manoeuvres).

Train de cerfs-volants du Cne Jacques Saconnet - Carte postale d'époque.
Des accidents d'avions :
Le 19 mai, le Ltt Paul Diétrich a décollé de Reims à destination de Pont-Hubert (Troyes), en compagnie du Ltt Charles Mendès (cuirassiers) et du Sapeur Martin. Au moment de l'atterrissage, le moteur a calé et l'avion a fini sa course en capotant. Le monoplan a été détruit mais heureusement les 3 occupants n'ont pas été blessés. Un autre aviateur, le soldat de 2ème classe Charles Revol-Tissot a détruit son appareil en atterrissant dans un champ gorgé d'eau près de Chailles (Loir-et-Cher). Revol-Tissot est indemne.
Réception d'un triplace destiné à l'aéronautique militaire :
Le 22 mai, le chef pilote de la société Deperdussin Maurice Prévost a effectué, à Reims, la réception d'un triplace militaire Deperdussin. La note officielle de réception stipule que le trajet servant à l'évaluation de la vitesse a été effectué en 24mn51 à l'aller et 11 mn au retour. C'est à bord d'un Deperdussin triplace de ce type que le Ltt Antonin Brocard a battu le record mondial de hauteur à trois, le 28 avril 1913 et le voyage Reims-Lyon à trois, ces jours derniers.

Maurice Prévost, pilote de la société Deperdussin - Né le 22 septembre 1887 - Elève pilote de l'école Deperdussin de Reims-Bétheny - Brevet de l'Aéroclub de France n° 475 en date du 29 avril 1911 - Brevet de pilote militaire n° 38 en date du 26 août 1911 - 3ème du concours militaire de Bétheny en septembre 1911 - Record du monde de hauteur avec passager à 3200 m en décembre 1911 - Remporte la coupe Gordon-Bennett avec 200 km/h, au grand meeting de Reims, le 29 septembre 1913 - Chef pilote de la société Deperdussin - Décédé à Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre 1952 - Carte postale d'époque.
Le centre d'aviation militaire Blériot de Pau :
Le centre militaire Blériot de Pau, est maintenant définitivement organisé et fonctionne sous le commandement du Cne Brutus Casse, des lieutenants Marie de Malherbe (chef pilote), Léon Brulé, Léon Binda et Louis Roussel. Parmi les nouveaux venus, le capitaine Alphonse Bernard-Thierry, les sergents Henri Moutach et Lattigue ont pleinement réussi leurs premiers essais aux commandes de Blériot à moteur Gnôme de 50 ch. Le lieutenant Guy des Hautschamps et le sapeur Joseph Thoret se livrent à un entrainement intensif. Ils passeront bientôt leur brevet militaire.
Le lieutenant Pierre Sainte-Lague et les sous-officiers suivants : Sgt Maurice Faure, MdL Ferdinand Venson et les sapeurs Paul Vandal, Lucien Jaillet, René Cheveau, Chapelle, Jacques Bisson sont actuellement en formation.

Le Ltt Antonin Brocard, de l'escadrille D 6 de passage à Annecy, le 26 mai 1913 - Carte postale d'époque.
Atterrissage mouvementé :
Le 27 mai, le Ltt Pierre Redelsperger (13ème régiment de Dragons), détaché à l'école d'aviation militaire de Reims, arrivait à Melun. Ignorant où se trouvait le terrain de manoeuvre, il atterrit dans la quartier Pajol, mais géné par des rafales de vent, il dut atterrir à 300 mètres de là, dans un champ d'avoine. Après plusieurs rebonds et s'être accroché dans des fils de fer barbelés, il termina sa course contre un batîment en brique qu'il heurta. Heureusement, le pilote réussit à sauter de son appareil avant la collision et n'a pas été blessé. L'avion a été endommagé au fuselage, à l'aile droite et l'hélice a été détruite.
Le 28 mai, le Ltt Paul Gérard, commandant du centre militaire du Crotoy, décollait, aux commandes d'un biplan, à destination de Saint-Cyr. Surpris par la nuit alors qu'il survolait Pontoise, il n'a pas voulu s'engager au-dessus de la forêt de Saint-Germain et a préféré atterrir dans un champ. Il a pu repartir normalement, le lendemain.
Accident du Sgt Martinovitch :
Le 29 mai, le Sgt Michel Martinovitch, pilote serbe naturalisé Français, affecté au centre d'aviation de Reims, a eu un accident aérien à Cléry, près de Péronne. A cet instant, il effectuait une mission entre Reims et Amiens. Le pilote est indemne mais son avion a été sérieusement endommagé.
Capotage d'un hydravion à Saint-Raphaël :
Le 30 mai, au cours d'un exercice, un hydravion, piloté par le LV André Nové-Josserand, a capoté en rade de Saint-Raphaël à la suite d'un amerrissage raté. L'aviateur de la Marine est indemne. L'appareil, qui a subi des avaries importantes, a été remorqué au port par une vedette à vapeur.
Mort du Jean de Kreyder au camp d'Avord, le 30 mai 1913 :
Le 30 mai 1913, à 16 heures, le Ltt Jean de Kreyder décolle du camp d'Avord, où il est détaché du centre d'aviation de Lyon, pour rejoindre le polygone d'artillerie de Bourges, où il réside. Il devait procéder à des essais de lancement de petites bombes. De 17h30 à 18h00, il procéda à plusieurs largages de bombes devant la commision présidée par le LcL Gaillard-Bournazel. Après avoir redécollé, une grosse tempête se déchaina dans la zone du terrain. Tous les environs, incluant la ville de Bourges, furent pris dans la tempête. Géné par les intempéries qui soulevaient la poussière, il fut surpris par un bosquet d'arbres. Pour l'éviter, il fut un brusque virage trop prêt du sol. Une aile toucha et le Blériot XI s'écrasa et se disloqua. Le pilote, qui n'était pas attaché, fut éjecté la tête la première, au sol. Son avion est tombé à 100 mètres de l'ancienne ferme de François Grange, au milieu d'un champ voisin du polygone, près de la zone militaire.
Les secours arrivés sur place, trouvèrent le pilote encore vivant mais avec de très graves blessures à la tête, dont un enfoncement de la boîte cranienne sur 10 cm. Il ne restait aucun espoir de sauver cet officier qui agonisait. Malgré le déplacement du docteur Demouch qui habitait à proximité, le Ltt de Kreyder décéda quelques minutes plus tard sans avoir repris connaissance.
Le Ltt Jean de Kreyder avait 30 ans. Il appartenait au 54ème régiment d'artillerie et était sorti de l'école de Versailles en 1908. Le 24 janvier 1913, il avait obtenu le brevet de pilote militaire n° 200 et avait été affecté au centre d'aviation d'Avord. Il était ensuite détaché à Bourges pour effectuer des tests de tirs à l'école de pyrotechnie militaire.
Ses obséques ont été célébrées à la chapelle de l'hôpital militaire de Bourges en présence du général Foch, commandant en chef du 8ème corps d'armée, du colonel Renault, directeur du centre d'aviation de Lyon, du LCL Gaillard-de-Bournazel, président de la commission d'expériences de Bourges et du Cne Lebleu, commandant l'école d'aviation d'Avord, le 31 mai.

Ltt Jean de Kreyder - 54ème régiment d'artillerie - Brevet de pilote militaire n° 200 obtenu le 24 janvier 1913 - Détaché au centre d'aviation de Lyon - Tué au cours d'un accident aérien au camp d'Avord, le 30 mai 1913 - Photo collection Killer2lamor que je remercie pour son aide.

Photo du Blériot XI piloté par le Ltt Jean de Creyder tombé au camp d'Avord, le 30 mai 1913 - Carte postale d'époque.

Photo du Blériot XI piloté par le Ltt Jean de Creyder tombé au camp d'Avord, le 30 mai 1913 - Carte postale d'époque.
Création d'un centre d'aviation au Tonkin :
Le 30 mai, le département des colonies décide la création d'un centre d'aviation au Tonkin. Le poste principal sera construit dans les environs d'Hanoï.
L'escadrille du Maroc de Oudjda :
Les troupes marocaines, commandées par le général Alix, viennent de remporter un brillant succès. Cette victoire a été entièrement préparée par les aviateurs du centre d'Oudjda. Depuis une quinzaine de jours, les pilotes ont volé tous les jours au-dessus de la région occupée par les tribus adverses. Ils ont aussi relevé, à l'aide d'appareils photographiques mis en oeuvre par des observateurs, la topographie d'une région inconnue. Ils ont prouvé, grâce à ces missions, le rôle militaire que les avions pouvait avoir lors d'une campagne dans cette région d'Afrique. Les appareils utilisés étaient des monoplans biplaces Deperdussin.
Les mésaventures du Slt Jean Uberthier :
Le Slt Jean Uberthier est sorti du rang (de soldat à officier) et a gagné son épaulette d'officier dans l'aéronautique militaire (Brevet de l'Aéroclub de France n° 1119). En mai 1913, son monoplan prend feu à 1200 m d'altitude alors qu'il survolait la Loire. Il atterrit et pu circonscrire l'incendie de son appareil. Quelques jours plus tard, son avion réparé, il voulu repartir. Cette fois, c'est un fil de commande de vol qui casse et la course de décollage qui se termine en casse avion. Heureusement, il est indemne. Le 2 juin, alors qu'il survolait le village du Mez-de-la-Madeleine à 750 m d'altitude, le culbuteur d'une soupape se brisa. La tige, qui maintenait cet élément, n'étant plus maintenue, a détruit le capot moteur. Le monoplan frôla le toit de la ferme d'Hennepont et termina sa course d'atterrissage sur le dos. Encore une fois, l'officier s'en tira sans la moindre égratignure. Suspectant des sabotages successifs, il demanda que son avion fut inspecté par une commision militaire spécialisée. Deux jours plus tard, le Cne Alexis Duperron, du service technique de l'aéronautique (STA) vint inspecter le monoplan. Il prescrivit les réparations nécessaires et obligea le sous-lieutenant à faire tourner son moteur à vide pendant 3/4 h. Dans l'attente du départ, l'avion a été gardé par un piquet double de Dragons. Il obtiendra plus tard le brevet de pilote militaire n° 340 en date du 22 août 1913.
L'accident du soldat Pierre Chanteloup :
Le 3 juin, le soldat Pierre Chanteloup, du 1er régiment de Génie, a décollé, aux commandes d'un biplan, de Saint-Cyr-L'Ecole, à destination du Crotoy. Il devait livrer cet avion au Ltt Gérard, commandant le centre d'aviation du Crotoy. En route, il a été victime d'une légère panne de moteur et a été contraint d'atterrir au Grand Fitz-James, au Nord de Clermont (60). Le lendemain, après avoir réparé, il décolla en direction du Nord. Arrivé au-dessus du village d'Avrechy, son moteur s'arrêta et il dût atterrir au plus vite. Lors de sa finale d'atterrissage, il réussit à éviter des maisons mais fini sa course contre un pommier. Avant le choc final, il réussit à évacuer son appareil, roula au sol sans se blesser. Le biplan, fortement endommagé, n'a pu être réparé sur place et fut conduit à Clermont par camion.
L'accident du Sapeur René Bonnefond :
Le 4 juin, le soldat René Bonnefond (Génie), affecté au centre d'aviation du camp de Châlons, aux commandes d'un biplan, a été obligé d'atterrir près d'Ay, suite à une panne moteur. Au cours de l'atterrissage, l'avion capota, se retourna et fut sérieusement endommagé. Heureusement, l'aviateur a pu se dégager seul et n'a pas été blessé.
Vol de 1340 km pour le Ltt Antonin Brocard :
Le 4 juin, le Ltt Antonin Brocard termine une reconnaissance militaire tout à fait exceptionnelle. Il était aux commandes d'un Deperdussin à moteur Gnôme baptisé "Général Lafayette" offert à l'armée par les galeries Lafayette. Accompagné du sapeur Delage, il a relié en 8 jours Reims - Troyes - Dijon - Grenoble - Chambèry - Annecy - Lyon - Macon - Dijon - le camp de Mailly - Reims. Ce voyage de 1.340 km s'est déroulé sans incident. Cet officier s'était déjà illustré au cours des grandes manoeuvres de 1912, lors de plusieurs missions entre Reims et Buc avec 2 passagers et pour finir, en battant le record du monde avec 2 passagers à l'altitude de 2.300 mètres, le 28 avril 1913. Le Ltt Antonin Brocard, chef pilote du centre d'aviation de Reims, a toujours été fidèle aux avions Deperdussin. Il a obtenu le brevet de pilote militaire n° 123, le 6 juillet 1912.
La TSF dans les avions :
L'aéronautique militaire a entrepris l'installation de la TSF à bord de ses avions, dont la valeur comme appareils de reconnaissance sera ainsi considérablement augmentée. Les premiers essais viennent d'être effectués à Buc par le Cne Antonio Denys de Lagarde et du Ltt Paul Dietrich, à bord de leur Deperdussin biplace à moteur Gnôme.
L'accident du Ltt Escault :
Le 5 juin, le Ltt Escault (artillerie), affecté au centre d'aviation de Chalais-Meudon, a effectué un atterrissage difficile avec son monoplan au hameau de Léry, commune de Vineuil (Loir-et-Cher). L'aéronef a été ramené sur les terrains de la Boire, à Blois. Le lendemain matin, après que l'hélice ait été changée par les mécaniciens, il décida de décoller malgré un vent violent qui couvrait la région. Dès qu'il fut en l'air, son avion fut violemment secoué, piqua du nez et vient s'écraser sur le terrain sablonneux de la Boire. Sous le choc qui fut violent, la nouvelle hélice se brisa, le train d'atterrissage et une aile furent sérieusement endommagés. Cette fois, le monoplan fut démonté et embarqué à la gare de Blois à destination de Chalais-Meudon. L'officier n'a pas été blessé.
Le centre militaire Borel de Buc-Châteaufort :
Le 5 juin, le Ltt François de Vergnette de Lamotte, commandant du centre Borel de Buc-Châteaufort (Yvelines), a décollé dans la soirée à destination du camp de Mailly. Il doit relier Dijon - Belfort - Epinal et Nancy. Le Ltt Franck Delanney est rentré de Mourmelon, le Ltt Ferdinand Pégat est parti en direction de Rambouillet. Au-dessus du terrain, les sergents Alfred Clamadieu, Georges Benoist et Armand Pinsard effectuent des vols en altitude.

Sgt Alfred Georges Clamadieu - Né le 23 avril 1884 à Bussac (16) - Breevt de pilote militaire n° 270 obtenu le 24 mai 1913 - Pilote du centre d'aviation militaire Borel de Châteaufort (76) - Pilote de l'escadrille BO 9 puis BL 9 - Tué au combat, en compagnie du Cdt Emile Reymond, dans les environs de Limey (54), le 22 octobre 1914 - Leur Blériot XI-2 a été touché par l'infanterie allemande - Posé entre les lignes belligérantes, Clamadieu a été tué par balle près de l'avion et Reymond, grièvement blessé d'une balle aux reins - Il est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital de Toul, le même jour - Carte postale d'époque.
L'école d'aviation militaire d'Etampes :
Le 5 juin, le Sgt André Bridou, affecté à l'école d'Etampes, a accompli, aux commandes d'un Breguet U 3 à moteur Salmson système Canton-Unné, une mission sans escale de 230 km sur le parcours Châlons - Mourmelon - Reims - Sissonne - Camp de Mailly. Il faisait équipage avec un officier observateur pour ce vol. D'autre part, le Ltt Henri Sensevez a relié Villacoublay - Châlons à bord d'un Breguet à moteur Salmson. (voir la carte postale qui est consacrée au Sgt Bridou pendant les Grandes Manoeuvres de 1913)
Le dirigeable "Commandant Coutelle" bat le record de vitesse :
Le 5 juin, le dirigeable "Commandant Coutelle" a réalisé un vol d'essai de vitesse et a battu à cette occasion, le record de vitesse de tous les dirigeables militaires français. Il avait à bord 16 personnes, le comte de La Vaux pilote, M. André Schelcher, les Cdt Nizart et Perreau, le Capitaine de Vaisseau Noël, les capitaines Marotte, Demange, Jayet, le Lieutenant de Vaisseau Dutertre, le Ltt Caussin, M. Maurice Vernes, M. Montrie secrétaire de la légation du Siam et quatre mécaniciens.
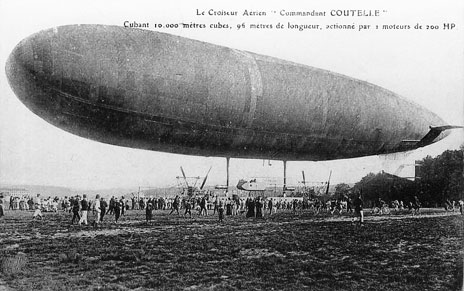
Le dirigeable "Commandant Coutelle" a battu le record de vitesse des dirigeables militaires français avec 16 personnes à bord, le 5 juin 1916 - Carte postale d'époque.
Le lieutenant Ulysse Lalanne muté au Maroc :
Le 6 juin, le Ltt Ulysse Lalanne est muté au centre d'aviation marocain d'Oudjda. Il emmène avec lui 2 Duperdussin monoplaces qui vont renforcer cette unité. Cet officier a participé aux grandes manoeuvres de 1912. Il appartenait à l'escadrille Duperdussin de Maubeuge. Il avait effectué des tests de lancement de bombes qui lui avait valu les félicitations du général Desaleux, gouverneur de Maubeuge. Un autre officier pilote de Maubeuge, le Ltt Victor Radisson ira le rejoindre, à partir du 4 décembre 1913.

Deperdussin T modèle 1912 n° 16 baptisé "Général-de-Coëhorn" de l'escadrille D 4 stationnée sur le terrain de Maubeuge - Tous les Deperdussin T et TT de cette unité portaient un nom de baptème - Le pilote est le Ltt Ulysse Lalanne - Carte postale d'époque.

Ltt Ulysse Lalanne pose aux commandes d'un Deperdussin modèle 1911 pendant sa formation de pilote militaire à Reims en juin-juillet 1912 - Né à Pamiers, le 7 août 1887 - Engagé à l'école spéciale de St-Cyr à compter du 1er octobre 1905 - Admis à la 90ème promotion "La dernière du Vieux Bahut" - Nommé Caporal, le 8 avril 1906 - Nommé Sergent, le 5 novembre 1906 - Nommé Sous-Lieutenant, le 24 septembre 1907 - Affecté au 24ème régiment d'infanterie coloniale stationné à Perpignan à compter du 9 octobre 1907 - Affecté au 2ème régiment de tirailleurs Tonkinois à compter du 21 février 1909 - Affecté à la 3ème compagnie de Sept Pagodes, le 1er avril 1909 - Nommé Lieutenant, le 25 septembre 1909 - Détaché à l'école des sous-officiers indigènes de l'Indochine à Haiphong, le 1er janvier 1910 - Affecté au 8ème régiment d'infanterie coloniale, le 11 mars 1910 - Retour vers la France à bord du courrier "Le Tonkin" du 11 mars au 10 avril 1911 - Affecté à la 4ème compagnie du 8ème régiment d'infanterie coloniale, le 11 juillet 1911 - Affecté à l'état-major au dépôt des isolés coloniaux Sainte-Marthe de Marseille, à compter du 21 novembre 1911 - Détaché au service de l'aéronautique militaire à compter du 21 novembre 1911 - Affecté au 25ème bataillon d'Aérostiers de Versailles - Elève pilote à l'école de pilotage de l’aérodrome Deperdussin Reims-Champagne à partir de mars 1912 - Brevet de pilote de l'Aéroclub de France n° 859, en date du 3 mai 1912 - Brevet de pilote militaire n° 128 obtenu à l'école de Reims, le 13 juillet 1912 - Participe au sein de la 3ème escadrille de réserve Deperdussin aux Grandes Manoeuvres de Touraine du 11 au 17 septembre 1912 - Placé en position de Hors Cadre, détaché au service de l’Aéronautique Militaire, par décret du 24 septembre 1912 - Pilote de l'escadrille D 4 à compter du 16 novembre 1912 - Désigné pour le 2ème groupe aéronautique de Maubeuge, le 1er janvier 1913 - Affecté au 1er groupe aéronautique au centre d'aviation d'Oudjda du 24 mai 1913 au 24 juillet 1914 - Pilote de l'escadrille MF 33 du 2 octobre 1914 au 3 mai 1915 - Chevalier de la Légion d'Honneur, le 24 novembre 1914 - Commandant de l'esacdrille MF 55 du 3 mai 1915 au 15 mai 1916 - Nommé Capitaine, le 5 mai 1915 - Nommé Adjoint tactique au chef de secteur aéronautique de la Vème armée, à compter du 15 mai 1916 - Affecté à la 6ème armée comme commandant de secteur en juin 1916 - Affecté au cabinet du Sous-secrétariat de l’Aéronautique Militaire et Maritime à compter du 20 novembre 1916 - Nommé Chef de Bataillon à titre temporaire, le 20 octobre 1917 - Nommé Chef adjoint du chef de cabinet du sous-secrétaire d’État à l’Aéronautique militaire et maritime, le 23 novembre 1917 - Croix de Guerre 4 palmes et une étoile de vermeil - Nommé Promu Chef de Bataillon à titre définitif, le 25 mars 1919 - Affecté à l’Organe de Coordination Générale de l’Aéronautique comme chef du 1er Bureau du 13 juin à septembre 1919 - Admis à la 2ème promotion de l’École supérieure de Guerre à compter du 4 novembre 1919 - Hospitalisé à l’hôpital militaire de Toulouse, le 22 septembre 1920 - Sorti de l’hôpital de Toulouse et évacué sur le sanatorium de Gorbio (Alpes-Maritimes), le 6 décembre 1920 - Décédé à l'hôpital complémentaire de Menton (13) des suites d'une tuberculose pulmonaire ouverte, le 17 décembre 1920 - Ulysse Lalanne repose au cimetière de Terre-Cabade à Toulouse - Photo mise en ligne sur le site Gallica de la Grande Bibliothèque de France.
Liste des pilotes du centre d'aviation d'Oudjda au Maroc dans l'ordre d'arrivée :
Cne Robert Jeannerod - Chef du Centre d’Aviation du Maroc Oriental du 27 juillet 1912 au (entre le 4 et le 8) août 1914 -
Ltt Jules Bruncher du (23 ou 24) novembre 1912 au 6 novembre 1913 -
Ltt Auguste Souleillan du (1er ou 8) février 1913 au 24 septembre 1913, date de son décès -
Ltt Ulysse Lalanne du 9 juillet 1913 au 23 juillet 1914 -
Ltt Lucien Magnin du 23 novembre 1913 au XX août 1914 -
Ltt Victor Radisson du 12 janvier 1914 au (entre le 4 et le 8) août 1914.
Les manoeuvres navales à Toulon des 7 et 8 juin 1913 :
Pour la seconde fois, les avions ont pris part aux manoeuvres navales qui se sont déroulées au large de Toulon. Les avions et les dirigeables étaient destinés à jouer des rôles bien différents. Les premiers ont été employés aux missions d'éclairage et de reconnaissance des forces adverses et les seconds, succeptibles de voler plus loin et plus longtemps, ont mené des attaques avec la possibilité de lancer des bombes.
Plusieurs modèles d'avions ont été employés, soit basés à terre équipés de roues et en version hydravion, équipés de flotteurs. Ils ont permis d'augmenter le rayon de surveillance d'une centaine de kilomètres et de faciliter par beau temps, le repèrerage les sous-marins et les mines flottantes.

Hydravion Nieuport évoluant au-dessus de sous-marins pendant les manoeuvres navales au large de Toulon, les 7 et 8 juin 1913 - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

Hydravion Henri Farman amerrissant dans la rade de Toulon, pendant les manoeuvres navales, les 7 et 8 juin 1913 - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
Accident d'un avion du centre d'aviation d'Epinal :
Le 18 juin, un avion militaire piloté par le Ltt Jean Personne, affecté au centre d'aviation militaire d'Epinal, a capoté à l'Hôpital-le-Mercier, près de Paray-le-Monial, à la suite d'une panne moteur. L'officier a été gravement blessé et a été transporté dans une maison voisine où un docteur a effectué les premiers soins.
Accident d'un biplan du camp de Châlons :
Le 18 juin, un biplan militaire, qui se rendait du camp de Châlons au camp de Sissonne, s'est écrasé dans les environs de Branscourt. L'équipage était composé du Sgt Vandel et du sapeur Stobaker qui ont été blessés. L'appareil a été détruit.
Mort du Sapeur Marcel Debever :
Le 18 juin, le Sapeur Marcel Debever, affecté au centre d'aviation militaire d'Etampes-Villesauvage, évoluait en compagnie de deux camarades, au-dessus du village d'Etampes à l'altitude 1.000 mètres. Alors qu'il revenait au terrain pour atterrir, son avion, qui était encore à 600 m d'altitude, piqua du nez, plein gaz moteur. N'ayant pas réussi à empêcher la chute folle de son avion, il sauta la tête la première alors qu'il n'était plus qu'à 10 mètres du sol. Le biplan s'écrasa et se disloqua. Marcel Debever, qui n'avait que 22 ans, a été tué sur le coup. Son corps a été ramené à l'hôpital d'Etampes. Ses obsèques ont été célébrées, en présence des colonels Bouttiaux et Romazotti, des capitaines Voisin, Etevé, Bertin, du Ltt Massol, commandant du centre d'aviation militaire d'Etampes, en l'église Notre-Dame, le 20 juin 1913.

Monument érigé à l'endroit de la chute de l'avion du Sapeur Marcel Debever au sud-est de Ville-Sauvage - Photo Claude Dannau que je remercie pour son aide.

Détail du monument érigé en hommage au Sapeur Marcel Debever - Il se situe dans un bois, au sud-est de Ville-Sauvage - Photo Claude Dannau que je remercie pour son aide.
Exercice sur l'aérodrome militaire de Buc :
Le 19 juin, un exercice a été réalisé sur le terrain de Buc. Un message est arrivé en stipulant l'exercice suivant : "Tous les pilotes disponibles doivent immédiatement faire un vol d'entraînement d'une heure.". Les capitaines Joseph Barès, Robert Farges, Alexis Duperron, Louis de Göys de Mézérac, les lieutenants Arthur Noé, Louis Mauger Devarennes, Joseph Lussigny, Maurice Collard, Jean d'Aiguillon, l'Adj Honoré Boissière, le Sgt Paul Mouillères ont effectué le vol demandé.
Une formation de Maurice Farman MF 7, commandée par le Cne Joseph Barès, composée du Cne Robert Farges, des Lieutenants Arthur Noé, Louis Mauger Devarennes, Joseph Lussigny est parti pour Pontoise.
Le choix du Blériot en tandem :
Le 21 juin, le Cne Jacques Faure et le Ltt Marie Gouin ont rejoints par la voie des airs, venant de Saint-Cyr, la commission des marchés de l'établissement de Chalais-Meudon, composée du Capitaine Destouches, des lieutenants Marcel Boucher, Edmond Gaubert ... A bord d'un blériot biplace en tamdem, les pilotes Pégoud et Domenjoz ont emmené successivement tous les membres de la commission comme passagers, puis les deux officiers ont piloté eux-mêmes. La commission a adopté de façon définitive ce modèle de Blériot en tandem pour les prochaines commandes de l'aéronautique militaire.
Le terrain de la Ferté-Alais :
Le 23 juin, un terrain d'atterrissage va bientôt être établi à la Ferté-Alais. Les travaux du terrain de Romorantin sont terminés.
Mort de Léon Foulquier au camp de Châlons :
Le 26 juin, l'aviateur Léon Foulquier, ancien aviateur du centre militaire de Reims, aux commandes d'un monoplan, avait décollé de Reims pour relier le camp de Châlons. Libéré de ses obligations militaires depuis 6 jours, il venait d'être engagé comme pilote par un constructeur d'avions de Reims. Arrivé à la verticale du camp de Châlons, et alors qu'il était encore à 70 m d'altitude, les témoins virent son avion piquer et s'écraser. Souffrant de multiples fractures, il respirait encore quand les premiers soins arrivèrent. Il décéda des suites de ses blessures alors qu'on l'évacuait par brancard vers l'hôpital.
|
Mort du Cne Paul Rey à Villenauxe (Aube), le 2 juillet 1913 :
Le Cne Paul Rey, affecté au centre militaire de Lyon, était détaché à Etampes pour y réceptionner les appareils livrés par les constructeurs aéronautiques à l'aéronautique militaire française. Le 2 juillet 1913, à 7h30, il décolle, en compagnie du sapeur Bouchayer. Vers 10h30, alors qu'il vole à une altitude de 100 mètres dans les environs de Mongenost, il entame une procédure d'atterrissage trop brusque et tombe en perte de vitesse. A une vingtaine de mètres d'altitude, son passager saute et tombe lourdement au sol. L'avion s'écrase et le capitaine est tué sur le coup. Il sera relevé avec le crâne défoncé et un bras cassé. Son corps sera transporté dans une ferme voisine. Le sapeur Bouchayer, gravement blessé, a eu la machoire fracturée et le nez cassé. Il est sans connaissance. Cet accident est dû à une panne moteur et consécutive à une volonté du pilote de vouloir atterrir rapidement en piquant à mort.

Photo de l'épave du HF 20 n° 92 du Cne Paul Rey écrasé dans les environs de Villenauxe (Aube), le 2 juillet 1913 - Carte postale d'époque.

Autre vue de l'épave du HF 20 n° 92 piloté par le Cne Paul Rey qui s'est écrasé dans les environs de Villenauxe (Aube), le 2 juillet 1913 - Au premier plan, le corps de l'aviateur qui n'a pas encore été emporté - Carte postale d'époque.
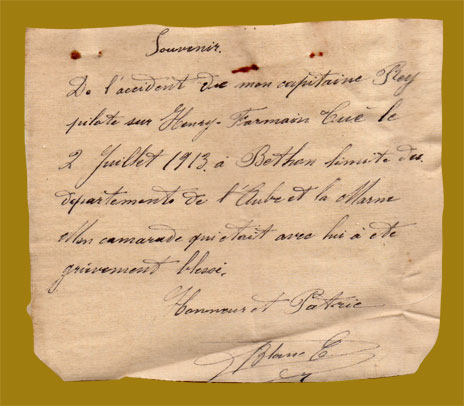
Morceau d'entoilage du HF 20 n° 92 de l'équipage Capitaine Rey / Sapeur Bouchayer détruit, le 2 juillet 1913 - Il a été conservé par le soldat Léon Blanc, un camarade du soldat Bouchayer - Léon Blanc, pendant la première guerre mondiale, sera pilote des escadrilles VB 105 et SPA 62 - Photo collection Marc Dantlo que je remercie pour son aide.
L'escadrille d'avions de Biskra :
Le 3 juillet, trois des quatre appareils de l'escadrille, qui sera stationnée à Biskra (Algérie), sont arrivés à Tunis. Ils resteront tout l'été sur place avant de gagner leur lieu de stationnement définitif. A Tunis, les avions seront stationnés sur le champ de courses de Kassar-Saïd, que le Ltt Ernest Reimbert a personnellement choisi.

Ltt Ernest Reimbert, commandant de l'escadrille de Biskra
Carte postale d'époque.
Vol de reconnaissance sur la frontière :
Le 9 juillet, le Cne Rozerezu, affecté au centre de Reims, a réalisé une mission de reconnaissance sur la frontière de l'Est. Décollant au matin de Nancy, il a atterri au champ de Mars de Lunéville. Après une escale technique d'une 1/2 heure, il est reparti pour survoler le fort de Manonviller.
Mort du sapeur Lamarle à Mourmelon-le-Grand :
Le 22 juillet, un grave accident s'est produit sur le terrain de Mourmelon-le-Grand. Un biplan, piloté par le Ltt Gabriel, avec le sapeur Lamarle comme passager, a capoté lors de sa course de décollage. Le sapeur Lamarle a été tué sur le coup, le moteur lui ayant écrasé la tête. Le pilote s'en tire avec des blessures supperficielles.
Une sortie du dirigeable "Commandant Coutelle" :
Le 24 juillet, le dirigeable "Commandant Coutelle" a fait une sortie de 2 heures. Après avoir survolé Versailles et les localités des environs, il a regagné le terrain de Saint-Cyr où se trouve son hangar.
Inauguration de la station d'aviation de Brienne-le-Château :
Le 27 juillet, la station d'aviation de Brienne-le-Château, érigée grâce aux fonds recueillis dans le département de l'Aube et avec le comité national pour l'aviation militaire, a été inaugurée. A cette date, la souscription nationale a permis d'acheter 170 avions, d'équiper 65 stations d'aviation et d'assurer la formation de 80 pilotes. Il s'agit à chaque fois d'un terrain plat, d'une superficie au moins 10 hectares, d'une longueur et d'une largueur ne pouvant être inférieure à 300 m et équipée d'un hangar de 20 x 20 m.
Inauguration du champ d'aviation de Valenciennes :
Le 27 juillet, inauguration du champ d'aviation de la Targette, près de Valenciennes. A cette occasion, le Caudron G II n° 20 baptisé "Valenciennes", offert par la ville, a été remis officiellement à l'aéronautique militaire.
Navires affectés à l'aviation maritime :
Le 29 juillet, le port de Rochefort a reçu l'ordre de réarmer les torpilleurs 183 et 187. Leur vitesse de pointe va être améliorée et ils recevront une affectation pour l'aviation maritime. Ces deux navires avaient été désarmés et placés en réserve suite au départ de la flottile de Rochefort.
Accident pour l'escadrille du camp de Sissonnes :
Le 4 août, six biplans et un monoplan, en provenance du camp de Sissonnes, se sont posés sur le terrain d'Amiens. Après avoir ravitaillés, ils sont repartis à destination du Crotoy. L'avion du Sgt Georges Boiteau ne pu prendre de la hauteur et parti tout droit dans un champ. L'aile droite, qui a durement touché, a été brisée. Le pilote n'a heureusement pas été blessé.
Grave accident pour le Ltt René Marlin :
Le 8 août, les lieutenants René Marlin et Charles Mendès s'entrainaient aux vols sur de grandes distances en reliant Reims - Douai - Boulogne-sur-Mer - le Crotoy - Rouen - Amiens. A seulement 8 kms d'Amiens, l'avion, piloté par le Ltt Marlin, est pris dans des rafales de vent et s'écrase entre Saveuse et Guignemicourt. L'appareil est complétement détruit mais l'aviateur échappe de justesse à la mort en se blotissant entre le réservoir et le capot. Il n'a pas été blessé.
L'avion "Ville-de-Saint-Dié" baptisé officiellement :
Le 8 août, une manoeuvre s'est déroulée sur le plateau de Nompatelize (Nord-Ouest de Saint-Dié-des-Vosges). Elle mettait en oeuvre, sous le commandement du général Gérard, les 3ème, 10ème, 17ème, 20ème et 31ème bataillons de chasseurs à pied, 6 batteries d'artillerie et un escadron de cavalerie. Quatre avions stationnés à Nancy y ont pris part en survolant les troupes engagées à des altitudes comprises entre 500 et 800 mètres. En fin d'exercice, ils ont été atterrir sur le terrain d'aviation de Sainte-Marguerite. Une des quatre appareils e a été offert à l'armée à l'occasion de la souscription nationale. Après un vin d'honnuer, les autorités civiles se rendirent au terrain pour baptiser officiellement l'avion "Ville-de-Saint-Dié".
Le Ltt Alexandre Gourlez en Belgique :
Le 10 août, le Ltt Alexandre Gourlez issu des chasseurs à pied et détaché au centre d'aviation de Belfort, a atterri sur le terrain de manoeuvres de Ronchis (Bruxelles). Chargé d'une mission d'étude auprès de l'armée belge, il est accompagné du sapeur Ampe, son mécanicien.
Trajet Toul-Albi pour le dirigeable "Adjudant-Vincenot" :
Le 15 août, le dirigeable "Adjudant-Vincenot", attaché au centre aéronautique de Toul, a décollé à destination d'Albi pour participer aux grandes manoeuvres du Sud-Ouest qui vont se dérouler en septembre. En fin de journée, il a rejoint sans problème le terrain d'Issy-les-Moulineaux, au Sud-Ouest de Paris. Ce dirigeable est bien connu des parisiens car avant d'être rattaché à Toul, il avait son hangar à Lamotte-Breuil (60).
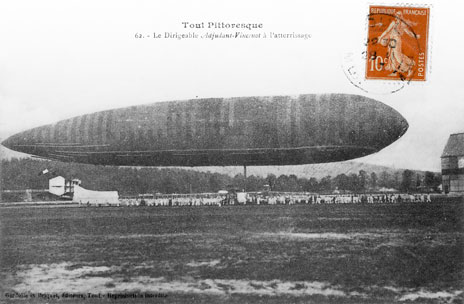
Dirigeable "Adjudant-Vincenot" stationné en bordure du champs de manoeuvres de Dommartin-lès-Toul, près de Toul (54) - Il avait comme caractéristiques techniques : Longueur 85 m - Equipé de deux moteurs Clément Bayard de 120 ch - Vitesse maximale 50 km/h - Rayon d'action 400 km - Equipage de 7 hommes - Doté d'un appareillage de télégraphie sans fil en 1912 - Il est photographié devant son hangar - Carte postale d'époque.
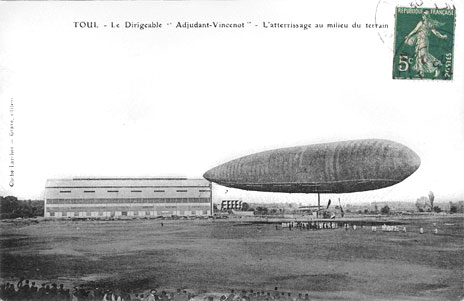
Vue générale du terrain de manoeuvres et du hangar abritant le dirigeable "Adjudant Vincenot" à Dommartin-lès-Toul - Carte postale d'époque.
Accident du Sgt Lucien Bégou du centre d'aviation d'Avord :
Le 17 août, le Sgt Lucien Bégou, affecté au centre d'aviation d'Avord, a eu un accident qui aurait pu avoir des conséquenses dramatiques. Aux commandes d'un monoplan, il se présente pour atterrir à Levroux. Au moment où les roues de son appareil allaient toucher le sol, il aperçu 3 jeunes enfants qui courraient dans sa direction. Ayant déjà coupé l'allumage, il donna une brusque impulsion vers la droite en manoeuvrant le gouvernail de profondeur pour éviter le groupe d'enfants. Alors qu'il allait finir sa course contre un mur, le train d'atterrissage accroche un treillage métallique et capote. Les dégâts sont importants avec une aile brisée, l'hélice et le gouvernail cassés. Bégou n'a pas été blessé.
Les forces en présence aux grandes manoeuvres :
Les grandes manoeuvres du Sud-Ouest se dérouleront sur la rive gauche de la Garonne, dans la zone comprise entre ce fleuve et l'un de ses affluents, la Baïse. Les moyens aériens en aviation et aérostation vont être engagés en nombre lors de ces exercices en campagne.
Pour l'aérostation militaire :
- à Albi - pour le parti bleu - un hangar démontable.
- à Pau - pour le parti rouge - un hangar fixe.
Pour l'aéronautique militaire :
- à Agen-la-Garenne - pour le parti Nord
- à Toulouse-Blagnac - pour le parti Sud
- à Bordeaux - pour le parti Nord - réserves
- à Carcassonne - pour le parti Sud - réserves
- 3 escadrilles pour chacun des 2 partis.
Escadrille de Biskra en Algérie :
Le 21 août, le Ltt Jean Cheutin, qui appartient à l'escadrille de Biskra, dans le Sud algérien, a réceptionné un biplan à Saint-Cyr. Aux commandes de cet appareil et en compagnie d'autres aviateurs, il va tenter la traversée du Sahara.
Le général Bernard nommé directeur de l'aéronautique militaire :
Le 24 août, le journal officiel a annoncé la mise à la disposition du ministre de la Guerre du général Bernard qui prend le commandement de l'aéronautique militaire. Il est chargé d'examiner le fonctionnement de tous les corps et des services intéressant l'aérostation et l'aviation. Il pourra renseigner le ministre sur l'état actuel des moyens aériens et lui proposer les mesures pour assurer son fonctionnement normal et régulier dans les meilleures conditions. Ces travaux devront être terminés avant la rentrée du parlement qui, dès l'ouverture de la session extraordinaire, sera appelé à consacrer par un vote de crédits, l'existence définitive de la direction de l'aéronautique.
Inauguration du monument en hommage au Ltt Georges Thomas :
Le 24 août, le monument élevé en hommage au lieutenant Georges Thomas, a été inauguré sur le territoire de la commune. Cet aviateur a été tué au cours d'un accident aérien à Givrauval, au Sud de Ligny-en-Barrois, le 22 septembre 1912. Sa famille était représentée par Mme Derouet, sa soeur et M. Alfred Lina.

Monument érigé sur la commune de Givrauval, près de Ligny-en-Barrois, en hommage au Ltt Thomas, tué à cet endroit, le 22 septembre 1912 - Carte postale d'époque.
Morts du Ltt Georges Sensever et du sapeur Louis Laforgue :
Le 25 août, un accident dramatique est survenu sur le terrain de Villacoublay, au Sud-Ouest de Paris. Un monoplan, monté par l'équipage composé par le Ltt Georges Sensever et le sapeur Louis Laforgue, a décollé pour deux heures de vol entrecoupées par des tours de piste. Lors du dernier tour au-dessus des vallées de Chevreuse et de la Bièvre, ils sont revenus au terrain pour se poser. Descendant en spirale, ils ont franchi la ligne des hangars et n'étaient plus qu'à une hauteur de 30 mètres. A cet instant, le monoplan piqua du nez et s'écrasa. Les témoins, accourus en nombre, trouvèrent le Ltt Sensever tué sur le coup avec le crâne défoncé. Son passager, le sapeur Laforgue était toujours en vie mais souffrait d'une fracture à la base du crâne. Une ambulance militaire en provenance de l'hôpital militaire de Versailles fut appelée en urgence et le médecin-major Ferry se mit immédiatement en route. Malheureusement, les blessures de Laforgue étaient beaucoup trop graves, il succomba avant que les secours n'arrivent à lui. Ces deux aviateurs avaient en outre de nombreuses fractures aux membres inférieurs. Leurs dépouilles mortelles ont été transportées à l'hôpital militaire de Versailles où ils seront veillés par leurs camarades.
Le lieutenant Georges Sensever était né le 15 février 1885 à Larreule (Haute-Pyrénées). Il appartenait au 3ème régiment d'artillerie coloniale et était détaché au centre d'aviation de Villacoublay.
Le sapeur Louis Laforgue était né à Saint-Clars (Gers). Ingénieur électricien, il appartenait à la 3ème compagnie du 1er groupe aéronautique et avait 22 ans.
Affectations dans les troupes aéronautiques pour la classe 1913 :
Le ministre de la Guerre, M. Eugène Etienne, adresse une circulaire précisant les conditions d'affectations professionnelles au sein de l'aéronautique militaire pour les appelés de la classe 1913.
En voici un résumé :
"Les dispositions de l'instruction du 15 mars 1913 précisant les conditions dans lesquelles s'effectueront les affectation professionnelles dans les troupes d'aéronautique des appelés de la classe 1912 sont applicables à la classe 1913, en ce qui concerne les 3 catégories d'appelés définies à l'article 1er de la dite instruction. Les directeurs des écoles d'aérostation ou d'aviation, les présidents de sociétés aéronautiques feront parvenir d'urgence au général inspecteur permanent de l'aéronautique militaire la liste des jeunes gens succeptibles de subir les épreuves instituées pour constater leur aptitude au service de l'aéronautique militaire. Ces listes seront accompagnées de tous renseignements utiles au sujet de l'instruction suivie jusqu'à ce jour par les élèves.
Les renseignements concernant les hommes de professions spéciales seront recueillies d'urgence par le général inspecteur permanent de l'aéronautique militaire, dans les conditions indiquées à l'article 11 de l'instruction du 15 mars 1913.
Les hommes de professions spéciales qui solliciteraient d'être incorporés dans l'aéronautique devront se mettre en instance dans le plus bref délai possible et au plus tard pour le 10 septembre, auprès du général, inspecteur permanent de l'aéronautique militaire, les demandes seront adressées directement à cet officier général, 6 boulevard des Invalides.
Les commisions d'examen seront constituées et les dates des épreuves fixées par le général, inspecteur permanent de l'aéronautique militaire qui en avisera directement les chefs d'école, les présidents de sociétés et les hommes de professions spéciales."
Inaugurations des terrains de Langres et de Saint-Dizier :
Le 26 août, les hangars des terrains d'aviation de Langres et de Saint-Dizier, financés par le comité national pour l'aviation militaire, ont été officiellement remis aux autorités militaires par le sénateur Reymond, président du comité.
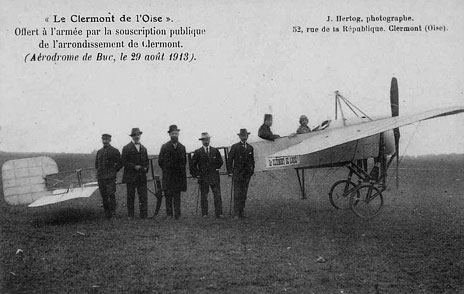
Un Blériot XI-2 offert aux armées par la souscription nationale par l'arrondissement de Clermont - Cet appareil a été officiellement baptisé sur le terrain de Buc, le 29 août 1913 - Carte postale d'époque.
Les moyens aéronautiques engagés dans les grandes manoeuvres :
Les escadrilles participant aux grandes manoeuvres feront mouvement par la voie des airs et leurs moyens techniques par voie terrestre. Les officiers observateurs seront répartis entre les terrains, les quartiers généraux et les escadrilles sur le terrain.
La première période des manoeuvres, du 7 au 10 septembre, sera consacrée à l'instruction. Puis viendra, du 11 au 17 septembre, l'exercice proprement dit avec un fonctionnement des unités comme en temps de guerre. Les reconnaissances aériennes, qui seront menées au-dessus des troupes, devront être faites à des altitudes comprises en 1.000 m (avions) et 1.500 m (dirigeables). Les réparations et le ravitaillement seront assurés sur les stocks, sans avoir recours à la main-d'oeuvre civile. Les pilotes resteront juges en dernier ressort, s'ils peuvent effectuer les missions demandées. Toute troupe à proximité de laquelle atterrira un dirigeable ou un avion devra lui porter assistance. Le fonctionnement des unités de l'aéronautique donnera lieu à des rapports qui seront accompagnés de notes et de propositions concernant l'emploi des officiers observateurs.
Un baptême de l'air qui termine mal :
Le 2 septembre, le LV Henri Lefranc, emmenait en vol pour un baptème de l'air, Mme Lefèvre, la femme d'un observateur de l'unité. Après que le vol se soit bien déroulé au-dessus du village de Bouy, il présenta son appareil pour atterrir sur le camp de Châlons-sur-Marne. Malheureusement, le biplan capota et le réservoir d'essence s'enflamma. Le LV Lefranc et sa passagère ont été évacués, grièvement blessés, avec de nombreuses fractures aux jambes et de graves brûlures.
La TSF en aviation :
Le 4 septembre, un service quotidien de TSF (télégraphie sans fil) a été installé entre le poste de la Tour Eiffel et l'aéronautique militaire. Il comprend l'envoi journalier de 2 dépêches par le poste TSF de la Tour Eiffel, à 10 heures et à 17 heures. Ces messages seront spécialement destinés aux unités de l'aéronautique militaire. Ils permettront aux chefs de poste de dresser la carte synoptique du temps et de l'interpréter en tenant compte des conditions météo locales. De tels messages ont contribué à la réussite de nombreux raids comme le Paris-Breslau par Brindejonc-de-Moulinais, le Paris-Vitoria par Gilbert, le Paris-Berlin par Letort et récemment le trajet Paris-Albi par le dirigeable "Adjudant-Vincenot".
Les pilotes militaires seront formés dans des écoles militaires :
Le 9 septembre, l'inspection permanente de l'aéronautique militaire porte à la connaissance des constructeurs d'avions, une circulaire du ministre de la Guerre, les informant qu'à la date du 1er octobre 1914, les pilotes de l'armée seront uniquement entraînés dans les écoles militaires.
Le ministre de la Marine et l'aviation :
Le 12 septembre, M. Pierre Baudin, ministre de la Marine assiste à des essais d'hydravions pilotés par des officiers de Marine, pilotes de l'aérodrome de la Marine de Fréjus. Il se rendra le lendemain sur le cuirassé amiral de la flotte qui se trouve au golfe Juan. Le Croiseur "La Foudre", détaché au service de l'aérostation maritime, évolue avec son annexe, le torpilleur 226 "Etau", entre le golfe Juan et Villefranche pour préparer plusieurs missions qui seront effectuées les jours suivants.
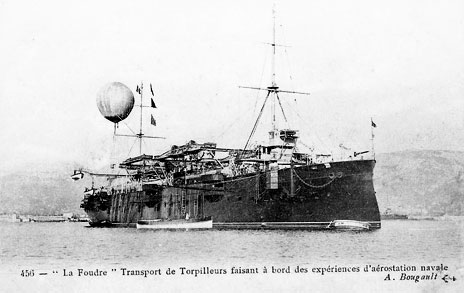
Croiseur "La Foudre" transport de vedettes lance-torpilles (torpilleurs à l'époque) et détaché pour l'occasion au service de l'aérostation maritime - Baptisé "Foudre", le 30 novembre 1891 - Armé à Bordeaux, le 1er février 1896 - Rejoint l'escadre de Toulon et participe à plusieurs campagne en Méditerranée - Le 25 août 1898, retour à Toulon - Il est utilisé comme transport de torpilleurs et navire atelier, rôle qu’il tiendra jusqu’à sa conversion en transport d’aviation, le 1er septembre 1911 - Transformé en porte-avions - Le 3 avril 1914, installation d’une plateforme d’envol sur l’avant par les Chantiers & Ateliers de Provence à Marseille - le 8 mai 1914, 1er décollage d’un Caudron G III par René Caudron - La plateforme est démontée après l’essai du LV de Laborde en juin 1914 - En 1914 sert en mer Ionienne et Adriatique - en décembre 1914, il est bâtiment-base et ateliers des chalutiers armés aux Dardanelles - en 1915-1916 il sert à Milo - en 1916-1917, il sert à Argostoli - Il est désarmé en 1921 - Vendu à l’entreprise Saglia pour démolition, le 27 mai 1922 - Carte postale d'époque.
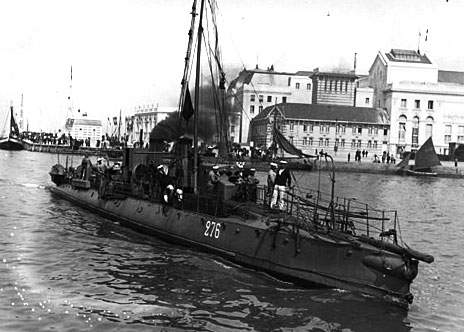
Torpilleur n° 226 type 201 - Construction commencée en 1897 - Mis à flot, le 10 juillet 1902 - Entré en service en septembre 1903 - Poids 86 tonnes - Puissance moteirs 1600 CV - Dimensions 39,2 m de longueur - 4,1 m de hauteur - 2.6 m de largeur - 2 tubes lances-torpilles de 457 mm et 2 canons de 37 mm - Equipage 27 hommes - Basé à Toulon de 1903 à 1912 - Renommé "Etau", annexe du Croiseur "La Foudre" (aviation maritime de St-Raphael) - Puis au service de la base de Sous-marins de Toulon - Retiré du service, le 30 octobre 1919 - Condamné en 1922 et vendu à Toulon pour être démantelé - Cette photo ne montre par le torpilleur n° 226 mais le n° 276 - Si un lecteur possède une photo du Torpilleur n° 226 "Etau", veuillez prendre contact avec l'auteur - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
Grandes manoeuvres du Sud-Ouest du 11 au 17 septembre 1913 : Le texte intégral de ce chapitre est de David Méchin que je remercie pour son aide.
Pour la 4ème fois depuis les grandes manœuvres de Picardie, l’armée française engage des aéroplanes et dirigeables dans ses grandes manœuvres de septembre qui se déroulent dans le sud-ouest. Aux appareils épars engagés en 1910 succèdent des escadrilles dotées d’avions militaires et bien soutenues par une solide logistique. Leurs évolutions seront suivies avec le plus grand intérêt par les militaires français et étrangers, mais aussi par les reporters de la Dépêche qui ne font que satisfaire l’immense enthousiasme de leurs lecteurs pour la chose aérienne en cette belle époque finissante.
Les bleus et les rouges :
L’armée française a vite compris l’intérêt des appareils aériens dès la mise au point des dirigeables. En 1905, le premier dirigeable militaire est employé pour effectuer des reconnaissances aériennes. En 1909, l’année de l’essor de l’aviation, quelques officiers prennent des cours de pilotage et lors des grandes manœuvres de Picardie du 9 au 18 septembre 1910, 14 avions sont engagés aux côtés des 4 dirigeables militaires. L’année suivante, 25 avions sont engagés dans les manœuvres de l’Est du 5 au 15 septembre 1912 et 22 dans les manœuvres des Ardennes du 10 au 18 septembre. A l’issue de celles-ci, un grand concours est organisé parmi les constructeurs d’avions afin de commander des appareils conçus sur un cahier des charges adapté aux exigences militaires. On crée dans la foulée un brevet militaire pour les pilotes, qui doivent remplir un carnet de vol… Du 11 au 17 septembre 1912, lors des grandes manœuvres de l’Ouest (dans le Poitou), pas moins de 60 avions militaires accompagnent les dirigeables. Pour la première fois, une partie des appareils ont été groupés en escadrilles permanentes, disposant d’une logistique propre et de camions ateliers.
Les grandes manœuvres militaires qu’organise le général Joffre dans le Sud-Ouest de 1913 ne constituent donc pas une première, ni dans l’emploi de l’aviation, ni même dans le nombre d’appareils engagés (6 escadrilles et 2 dirigeables). Elles seront l’occasion de développer l’indépendance logistique des escadrilles (dotées d’une cuisine roulante supplémentaire) et de généraliser les tests de transmission radio.
Sur les collines du Gers vont ainsi s’affronter une fois de plus les partis bleu et rouge. Le "Parti bleu", venu de l’ouest, est dirigé par le général Pau qui commande depuis son QG d’Agen 4 divisions d’infanterie (aux effectifs issus de Limoges et Bordeaux) et une division d’infanterie coloniale. A l’opposé, le "parti rouge" dirigé par le général Chomer dont le quartier général est à Toulouse, est fort de 4 divisions d’infanterie (originaires de Montpellier et Toulouse), une de cavalerie et d’un groupe d’artillerie lourde. Chaque camp se voit doté d’un dirigeable et de 3 escadrilles de six avions, une de monoplans et deux de biplans. Le parti bleu reçoit le dirigeable "Fleurus" qui se basera à Pau, et, prévues à Agen, les escadrilles BL 3 (Blériot), MF 5 (Maurice Farman), et HF 19 (Henri Farman). Le parti rouge se voit pour sa part doté du dirigeable « Adjudant Vincenot » qui ralliera Albi ainsi que des escadrilles D 6 (Deperdussin), V 21 (Voisin), et BR 17 (Breguet) qui devront se regrouper à Toulouse. De nouvelles expériences de télégraphie sans fil en vol sont prévues à bord des avions qui, règlementairement depuis le mois de juillet 1913, portent les premières cocardes tricolores sous les ailes.
L’énoncé de l’ordre de bataille témoigne assez peu de l’importance de l’évènement. Ce sont pas moins de cent mille hommes qui vont se déplacer dans les collines du Gers (département comptant deux cent mille habitants en 1913), mettant en branle une logistique énorme qui fait exploser le trafic ferroviaire. Trente bœufs par jour sont abattus pour nourrir un seul des quatre corps d’armées que comportent ces manœuvres…
Le Président de la République, Monsieur Poincaré, est attendu à Toulouse à la fin des opérations pour présider un grand banquet donné en l’honneur des officiers supérieurs. La capitale régionale se met en quatre pour le recevoir et une souscription publique est organisée pour financer les festivités. Y répond immédiatement le conseil général de la Haute Garonne, mais pas la municipalité de Toulouse ce qui entraîne les ricanements du journal satirique local, "le cri", qui ne manque pas d’ironiser sur le fait que Jean Rieux ira saluer le Président non pas en tant que Maire de Toulouse mais membre du conseil général… Avec la tension internationale, une ambiance très militariste gagne toutes les couches de la société et un excité qui a eu le malheur de crier "A bas l’armée !" dans une gare est promptement condamné à trois mois de prison par les tribunaux.
L’aviation, qui déjà remplit la page des sports des quotidiens de l’époque, s’inscrit dans cette fièvre militariste et "La dépêche" tiendra une rubrique quotidienne "Armée de l’Air" dans ses colonnes. Les débats sur l’arme aérienne se multiplient jusqu’à gagner les assemblées locales, le journal satirique toulousain "Le Cri" rapporte à ses lecteurs le compte rendu humoristique d’un débat bien réel ayant eu lieu au conseil général local : afin de promouvoir les vocations dans l’aviation militaire, il faudrait faire en sorte qu’un monoplan soit promu biplan après un certain temps de service, et qu’un biplan soit nommé triplan…
Une migration très suivie :
Dès la période préparatoire, la Dépêche rend fidèlement compte à ses lecteurs des mouvements de toutes les unités militaires. Pour son lectorat rural, le passage d’un régiment de fantassins, de cavaliers ou d’artilleurs à travers son village est un spectacle à ne pas manquer… Les mouvements des avions, déjà effectués ou attendus, font l’objet d’un suivi quotidien encore plus poussé, où est relaté la moindre anecdote. L’atterrissage d’un avion dans un village est un évènement local qui se doit de faire des lignes dans le journal. Et les occasions d’articles ne manquent pas, tant les incidents de parcours sont nombreux sur ces appareils particulièrement sensibles aux aléas du temps et dont les moteurs sont souvent capricieux. En voiture, les mécaniciens des escadrilles suivent les mêmes étapes d’environ 150 kilomètres mais des détours sont souvent imposés pour porter secours aux avions posés dans les champs. Quand ils arrivent sur place, une foule de curieux entoure déjà l’appareil, et c’est toujours sous les vivats que l’avion reprend sa route.
Pour les bleus, si la BL 3 peut rallier Agen à partir de sa base de Châtellerault sans casse, la MF 5 partie d’Epinal laisse deux Maurice Farman en réparation à Limoges, victimes d’atterrissages en pleine campagne dans les champs du massif central. La HF 19, partie de Lyon, traverse le massif central en 3 étapes pour gagner Périgueux, sans gros incidents. Mais le vol vers Agen voit deux avions s’égayer dans la nature où ils sont endommagés à l’atterrissage – ils devront poursuivre leur voyage en train. La population d’Agen, prévenue par la presse, se masse le 2 septembre autour du champ d’aviation improvisé de la Garenne, où s’affairent les hommes du génie portant "un aéroplane rouge sur le drap noir de leur veste" à monter les hangars et ateliers. Les premiers avions arrivent le lendemain.
A Toulouse, le champ d’aviation est aménagé au Polygone près de la cartoucherie le long de l’allée de Bayonne. L’autorité militaire a interdit au public l’accès au terrain, et a déployé 40 factionnaires tout autour pour empêcher les curieux de passer. Mais, en comptant les officiers de la garnison et les journalistes accrédités, il y a une quarantaine de personnes à scruter le ciel couvert le 3 septembre 1913. Les Deperdussin sont annoncés, une partie des mécaniciens de l’escadrille sont déjà sur place ainsi que leur chef, le capitaine Aubry. Les reporters attendent avec leurs carnets de notes et appareils photos. Deux tracteurs automobiles Renault bleu ciel (fonçant à 30 km/h !) font leur entrée. Les douze sapeurs qui en composent l’équipage montent en moins de 30 minutes les hangars de toile, qui sont disposés autour d’une construction en bois que des charpentiers ont tout juste bâti la veille. A 8 heures, le capitaine Aubry fait allumer un feu de paille, pour signaler à ses hommes le meilleur lieu d’atterrissage. Une épaisse fumée blanche monte vers le ciel. Les regards scrutent alors le ciel vers Saint Martin du Touch… Soudain, un cri : "En voilà un !" Puis un sapeur ayant une bonne vue en distingue un autre, plus bas que le premier. Le premier Deperdussin, baptisé "Ville de Porto-Rico", se pose et est aussitôt entouré d’une nuée de curieux. Son pilote emmitouflé dans sa tenue de vol, le lieutenant Zapelly, a péniblement lutté contre le vent d’Autan depuis Brive et est de fort méchante humeur : il rabroue les journalistes qui se rabattent aussitôt vers le second appareil, le ""Français de Moscou", qui vient de se poser peu après. Son pilote, le lieutenant Mortureux, se laisse volontiers prendre en photo et répond de bonne grâce aux questions des journalistes qui le lui rendent bien : "Grand, mince, belle silhouette d’officier, le lieutenant de dragons Mortureux fait avec bonne humeur le récit de son voyage. Les appareils s’élevèrent de Brive à partir de six heures, de trois en trois minutes. Le vent soufflait assez fortement, mais jusqu’à Montauban tout alla bien. Arrivés à Grisolles, par exemple, les aviateurs eurent beaucoup de mal à maintenir leur équilibre, surtout au dessus de la Garonne. Vous pouvez croire que nous avons été chahutés, conclut le lieutenant Mortureux. Mais baste ! On en a vu d’autres, et l’essentiel est d’être arrivés."
Alors que les journalistes pressent Mortureux d’autres questions, un cavalier arrivé au galop annonce au capitaine Aubry qu’un monoplan est tombé à Saint Martin du Touch. Tout le monde se précipite en auto sur les lieux du crash. Au village, un paysan les oriente "C’est à la Cassanette !" La route devient chemin cahoteux et les automobilistes sont ballottés. Ils sont rassurés par une paysanne : "Oh ! Mes bons messieurs, les pauvres, ils n’ont rien du tout. Ils ne sont pas faits mal. Tout le contraire, ils riaient. – Et l’aéroplane ? – L’aéroplane ? Elle est toute en morceaux". Ils trouvent le Deperdussin à 800 mètres d’une ferme, entouré d’un peloton de mitrailleurs cyclistes du 83ème RI. Les deux aviateurs grillent tranquillement une cigarette, le capitaine de Gorges fait alors le récit. "Nous volions à faible hauteur et je me dirigeais vers le Polygone, quand mon moteur s’arrêta net. Je pris mes dispositions pour atterrir. Devant moi un chaume s’offrait, que je crus praticable. Je descendis en vol plané. Mais, comme j’allais actionner mes commandes pour l’atterrissage, j’aperçus, dans le champ, de profonds fossés. C’était la culbute certaine. Brusquement, je fis demi-tour et revins sur mes pas. A ce moment, un violent remous coucha mon appareil sur le côté, dans une rangée de ceps. Vous savez le reste, l’hélice s’accrocha aux fils de fer qui limitaient les pieds de vigne. « La Bretagne » vira sur le côté gauche. La secousse fut un peu dure. Mais, en somme, nous n’avons cassé que du bois."
Un tracteur automobile arrive ensuite sur les lieux, et ses sapeurs démontent l’appareil et le ramènent à Toulouse. En fin de journée, se pose au Polygone le Deperdussin du lieutenant Devienne, parti le matin de Brive mais ayant dû se poser à Ondes suite à une panne. Le lieutenant Gauthier, parti d’Aurillac à l’aube, a du pour sa part se poser à Fronton en raison d’une panne sèche. Décollant pour Toulouse, il ne trouve pas le Polygone et se pose dans une prairie du quartier des Minimes. Avion et pilote rallieront le voyage en camion… Quant au dernier appareil, celui du lieutenant Dietrich, il est tout simplement resté à Limoges où le pilote assiste aux obsèques de son oncle, un général. Ainsi se déplacent les escadrilles en 1913…
Le 4 septembre, l’arrivée de l’escadrille de Voisin, est triomphale. Les journalistes sont toujours là depuis l’aube : "Au Polygone, pas de vent, mais une épaisse brume que le soleil ne parvient pas à percer. Puis la pluie tombe. Le capitaine Estirac arrive en voiture, précédant ses avions laissés à Castelsarrasin. Il fait disposer cinq larges bandes de toile qui sont les signaux d’atterrissage. Les spectateurs attendent sous la pluie… Une nouée de moustiques mènent une sarabande folle devant les hangars. L’huile de ricin les attire, dit un sapeur. On se croirait à Palavas les Flots, dit un autre. Puis un bruit de moteur se fait entendre à 8h20. Suivi d’autres… Cinq Voisin se posent superbement à la queue leu leu. Un cinq cent mètres au pas de gymnastique et nous voici près des avions. Le capitaine Estirac serre la main de ses pilotes. (…) Le caporal Mahieu et le sapeur Benoist sont connus comme pilotes civils. Le premier est recordman du monde en vol plané moteur éteint, le second s’est classé premier au meeting d’hydro-aviation de Tamise en Belgique et se distingua également, en 1912, aux poules de St Malo. Mais il manque un 6ème Voisin à l’escadrille, celui du lieutenant Le Vassor. Mahieu déclare que ce dernier lui a fait un signe, qu’il allait se poser. L’information est vite confirmée : il s’est posé aux Sept Deniers. Un de ses cylindres avait chauffé, le moteur rendit beaucoup moins. Comme il se trouvait au polygone, le pilote craignait de ne pouvoir atterrir au Polygone. Sagement, il descendit dans un champ. J’attend mon mécanicien, ajoute l’officier. Nous allons noyer le moteur de pétrole et je repartirai tout de suite. Autour du grand oiseau gris de fer une foule se presse. Tous et toutes veulent être les premiers à avoir signalé la chute de l’avion. On est dans le Midi…"
Remarquable exploit de l’escadrille V 21, ayant voyagé depuis sa base de Chalons sans casse, le robuste train d’atterrissage à quatre jambes muni de freins y étant pour beaucoup. Harassés de questions, les pilotes répondent volontiers aux journalistes et annoncent fièrement une moyenne de 75 km/h pour leur dernière étape depuis Castelsarrasin. Ils dévoilent aussi le confort de leur appareil, dont le fuselage coupe-vent leur permet "d’en griller une" tranquillement en vol : le caporal Mahieu exhibe fièrement sa sacoche en cuir contenant pipe, allumettes et tabac… Les journalistes ne manquent pas de rapporter l’ambiance de camaraderie et de décontraction entre officiers, sous-officiers et hommes du rangs aux commandes des appareils : "Avant tout, nous sommes tous des aviateurs" dit l’un d’eux. La dernière escadrille des rouges, la BR 17 du capitaine Massol, ne peut pas se vanter de tels résultats. Trois Breguet seulement se posent à Toulouse le 6 septembre (sergents Bridoux et Vuarin, sapeur Frantz), un ayant été détruit à Limoges et deux autres laissés derrière victimes d’incidents techniques. S’il intrigue les journalistes par son curieux fuselage en forme de poisson et ses ailes inclinées, le Breguet n’a pas la fiabilité des Voisin.
C’est la guerre !
Du 7 au 9 septembre, Voisin, Deperdussin et Breguet du parti rouge multiplient les vols autour de Toulouse, pour le plus grand bonheur des habitants, afin d’informer le général Chomer de la position de ses propres troupes, qui sont envoyées vers l’ouest à la rencontre des troupes bleues du général Pau. Les choses sérieuses commencent le 10 septembre, où les 3 Breguet, un Voisin et un Deperdussin sont envoyés vers le Gers reconnaître les positions de l’armée bleue, soit un vol de plus de 200 kilomètres. Malgré le temps splendide, tous les aviateurs du parti rouge reviennent bredouilles ! Le règlement des manœuvres leur impose de voler à plus de 1000 mètres pour se placer à une altitude où ils sont moins sensibles aux tirs des armes individuelles des fantassins. Mais cette altitude ne favorise pas l’observation à vue… De plus, les canards et oies du Gers sont témoins au sol d’un curieux manège : dès qu’un moteur se fait entendre, les militaires se précipitent à l’abri des maisons ou plongent dans les haies, tandis que les paysans se précipitent dehors pour contempler les avions ! De leur côté, les escadrilles bleues quittent toutes Agen pour le village gersois de Saint Clar.
Le 11 septembre, le général Chomer ordonne à "l’escadrille Estirac" de déménager vers une base avancée à l’Isle Jourdain ce qui est fait sans coup férir. Les Voisin ont à peine quitté le Polygone qu’apparaît sur Toulouse la silhouette du dirigeable bleu "Fleurus" qui fait mine d’attaquer. Peine perdue, deux avions rouges décollent et l’encadrent rapidement avant qu’il ait pu se placer au-dessus de sa cible. Il fait demi-tour et rentre à Pau, tout en observant les mouvements de troupes rouges sur Saint-Lys et Muret… L’ "Adjudant Vincenot", le dirigeable rouge, fait aussi son apparition ce jour au dessus de la ville rose pour partir vers le Gers reconnaître un large périmètre Auch-Lectoure-Fleurance. De leur côté, les avions bleus quadrillent le sud Toulousain. On repère un Blériot sur Beaumont sur Lèze, un autre sur Rieumes tandis que deux Farman sont aperçus respectivement sur Montégut et Saint-Lys…
Le 12 septembre, les premiers tirs se font entendre car les premiers "combats" ont lieu entre les troupes bleues et rouges alignées de part et d’autre de la rivière Gimone. De leur base avancée de l’Isle Jourdain, les six Voisin du capitaine Estirac multiplient les vols, renforcés par les Breguet et Deperdussin qui utilisent cette base avancée pour se ravitailler avant de repartir pour Toulouse. L’ "adjudant Vincenot" est pour sa part immobilisé dans son hangar suite à une avarie d’hélice. On commande d’urgence les pièces détachées à Paris…
Le 13 septembre, c’est l’affrontement généralisé sur les collines du Gers. L’armée bleue enfonce l’aile nord de l’armée ennemie, qui de son côté, enfonce son aile sud… Les armées tournent en rond ! Aucun parti ne semble l’avoir emporté, les deux généraux ayant l’un et l’autre pratiqué la doctrine en vogue au conseil supérieur de la guerre : l’offensive à outrance. Peu importe de savoir où va l’ennemi, le tout est de savoir où il est pour lui tomber dessus : "La volonté de l’ennemi ne compte pas, puisque nous avons la prétention de lui imposer la notre", écrit "La Dépêche" dans son dernier article d’analyse des manœuvres. La puissance de l’artillerie apportera un cruel démenti à ces conceptions un an plus tard…
Leçons aériennes
Ces manœuvres ont souligné les forces et faiblesses de l’aviation d’époque. Tout d’abord, elles auront permis de constater la valeur des différents types d’appareils. Les monoplans Blériot et Deperdussin sont peu adaptés pour les reconnaissances à vue. Les Breguet disparaîtront vite des effectifs dès les premières semaines de la première guerre mondiale, tandis que les Voisin, dont les reporters de La Dépêche soulignent le magnifique départ groupé de Toulouse le 20 septembre, deviendront avec les Farman la dotation standard des escadrilles d’observation du début de la guerre. Les faiblesses des dirigeables sont mises en évidence : vulnérables aux appareils ennemis (le "Fleurus" n’aurait pas survécu à son vol du 11 septembre en cas de conflit), leur grande autonomie en l’air est pénalisée par leur lenteur (50 km/h). Leur manque de maniabilité au sol rend leur emploi problématique sur des terrains de campagne : l’"Adjudant Vincenot" mesure 94 mètres de long, 15,5 mètres de diamètre et a un volume de 10 000 m3 . Pour peu que souffle un vent de travers de 8 mètres par secondes, soit 28 kilomètres heures, faut l’équivalent de 300 hommes pour le hisser dans son hangar ! Les commentateurs de l’époque parlent aussi d’équiper de pièces d’artillerie anti-aérienne les environs des hangars à dirigeables, car on pressent la vulnérabilité de ces installations qu’une seule bombe lancée d’un avion aurait tôt fait de réduire en cendres… L’unique but des escadrilles de 1913 est la reconnaissance ; néanmoins, la spécialité du bombardement, absente de ces manœuvres, est sérieusement étudiée à l’époque, le constructeur Michelin offrant même une coupe récompensant l’aviateur ayant effectué le meilleur bombardement militaire. On peut même voir dans l’interception du "Fleurus" au dessus de Toulouse le 11 septembre comme la première expérience improvisée de chasse. L’Histoire aime bien les clins d’œil : si l’on ignore quels sont les appareils et les aviateurs ayant participé au vol d’interception, c’est un des pilotes de Breguet présent au Polygone et possible participant du vol qui remportera le 5 octobre 1914 la première victoire aérienne homologuée de l’histoire de l’aviation : Le sapeur Joseph Frantz…
Ordre de bataille des escadrilles des grandes manœuvres de septembre 1913 :
Armée Bleue (Général Pau) : les escadrilles du parti bleu sont regroupées à Agen. Le 10 septembre, elles se déploient sur le terrain avancé de Saint Clar, dans le Gers.
-
Escadrille BL 3 équipée d'avions Blériot XI commandée par le Capitaine Hubert Jacquet : Basée à Châtellerault. Pilotes : lieutenants Edmond Gaubert, Roger Tretarre, Marcel Boucher, Georges Bellemois, sergent Georges Caron, caporal André Blaignan.
-
Escadrille MF 5 équipée d'avions Maurice Farman MF 7 commandée par le Capitaine Marie de St Quentin : Escadrille venant d’Epinal. Pilotes : lieutenants Pierre Grézaud (avion n° 95), Paul Bordes (n° 93), Jean-Marie Godot (n°94), Michel le Ray d’Abrantès (n° 92), maréchal des logis Aristide Quennehen (n° 97), caporal Guy d'Autroche (n° 91).
-
Escadrille HF 19 équipée d'avions Henri Farman HF 20 commandée par le Capitaine Pierre Voisin : Escadrille venant de Lyon. Pilotes : lieutenants Gérard Villa, Maurice Gabriel, Camille Fuzier, maréchal des logis Pierre Clément (HF 20 n°3 "Ville-de-Dijon), brigadier Georges Pelletier-Doisy ("Ville-de-Vichy"), sapeur Louis Blot.
-
Détachement de dirigeable commandé par le Commandant Richar : Le dirigeable de ce détachement est le "Fleurus", stationné à Pau.
Pilotes : capitaine Tixier et lieutenant Hennequin. Mécaniciens : adjudant Gérard, maréchaux des logis Maisonneuve et Godefroy.

Alignement des Blériot XI de l'escadrille BL 3 sur le terrain de Saint-Clar (Gers) - L'avion du milieu est le n° 213 - Photo collection Sandrine Sénéchal que je remercie pour son aide.
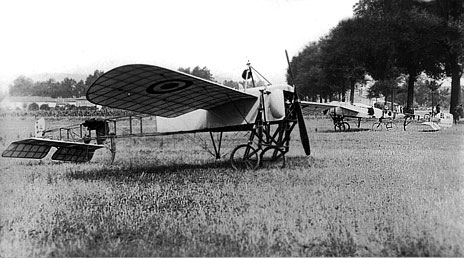
Blériot XI n° 84 appartenant à l'escadrille BL 3 déployés dans le Gers à l'occasion des Grandes Manoeuvres de 1913 - Photo collection Sandrine Sénéchal que je remercie pour son aide.

Blériot XI n° 183 de l'escadrille BL 3 qui a terminé son atterrissage dans un champ de mais - Photo collection Sandrine Sénéchal que je remercie pour son aide.

Vue des HF 20 de l'escadrille HF 19 sur le terrain de Saint-Clar pendant les grandes manoeuvres de 1913 - Les pilotes se consultent avant de partir en mission - Photo collection Sandrine Sénéchal que je remercie pour son aide.

Le MdL Pierre Clément pose à bord du HF 20 baptisé "Ville-de-Dijon" appartenant à l'escadrille HF 19 affectée pendant les grandes manoeuvres à l'armée bleue - Cette unité est normalement stationnée à Lyon - Il a été offert aux Armées à l'occasion de la souscription nationale - Photo collection Sandrine Sénéchal que je remercie pour son aide.

Le Brigadier Georges Pelletier-Doisy pose à côté de son HF 20 n° 83 baptisé "Ville-de-Vichy" appartenant à l'escadrille HF 19 affectée pendant les grandes manoeuvres à l'armée bleue - Il a été offert aux Armées, le 22 juin 1913, à l'occasion de la souscription nationale - Photo collection Sandrine Sénéchal que je remercie pour son aide.

Le Cne Pierre Voisin, commandant d'unité, pose à côté du HF 20 n° 89 baptisé "Jeanne d'Arc " appartenant à l'escadrille HF 19 affectée pendant les grandes manoeuvres à l'armée bleue - Il a été offert aux Armées, le 3 juillet 1913, à l'occasion de la souscription nationale - Photo collection Sandrine Sénéchal que je remercie pour son aide.

Dirigeable "Fleurus" - Construit en 1912 dans les ateliers aérostatiques de Chalais-Meudon - 2 moteurs Clément-Bayard de 4 cylindres à refroidissement par eau de 80 ch - Vitesse 58 km/h maximum - Plafond 1.000 m - Rayon d'action : 700 km - Poids 5,2 t - Longueur : 77 mètres - Diamètre : 12,4 m - Volume de gaz : 6.500 m3 - Effectua la trajet Pau-Saint-Cyr long de 680 kilomètres à la moyenne de 54 Km/h - Détruit en juin 1918 - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

Vue de la nacelle du dirigeable "Fleurus" - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
Armée Rouge (Général Chomer) : les escadrilles du parti rouge stationnent au Polygone de Toulouse. A compter du 11 septembre, seule l’escadrille V 21 est basée sur un terrain avancé à l’Isle Jourdain, dans le Gers.
- Escadrille D 6 équipée d'avions Deperdussin type T commandée par le Capitaine Jules Aubry : Escadrille venue d’Etampes. Pilotes : capitaine René Degorge (avion "La Bretagne"), lieutenants Alfred Zappelli ("Ville de Porto Rico"), Jean Mortureux ("Français de Moscou"), Adrien Gautier, Jean Devienne, Paul Dietrich.
- Escadrille V 21 équipée d'avions Voisin type L commandée par le Capitaine Jean-Pierre Estirac : Escadrille venue de Chalons. Pilotes : lieutenants Jacques Levassor (avion n° 15), Paul Leclerc (n° 16), sergents Georges Boiteau (n° 17), Paul Laporte (n° 18), caporal Michel Mahieu (n° 19), sapeur 1ere classe Georges Benoist (n° 20).
- Escadrille BR 17 équipée d'avions Breguet U 1 commandée par le Capitaine Edouard Massol : Escadrille basée à Montmorillon. Pilotes : lieutenants Gabriel Migaux, Vivarin, sergents André Bridou, France Vuarin, René Vidart, sapeur Joseph Frantz.
- Détachement de dirigeables commandée par le Commandant Labadie : Le dirigeable du parti rouge est l’ "Adjudant Vincenot", basé à Albi.
1er équipage - Pilotes : Capitaines Peaucellier et Izard. Mécaniciens : adjudant Anthenume, maréchal des logis Abadie.
2ème équipage - Pilotes : lieutenants Joux et Paquignon. Mécaniciens : Messieurs Villeroy et Durand.

Dirigeable "Adjudant-Vincenot" - Longueur 94 m - Equipé de deux moteurs Clément Bayard de 120 ch - Vitesse maximale 50 km/h - Rayon d'action 400 km - Equipage de 7 hommes - Doté d'un appareillage de télégraphie sans fil en 1912 - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
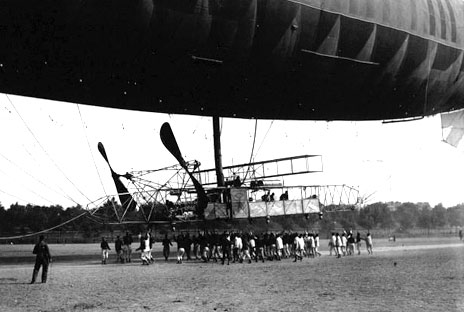
Vue de la nacelle du dirigeable "Adjudant-Vincenot" - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
Carte postale émise à l'occasion des Grandes manoeuvres du Sud-Ouest - Le général Joffre assure la direction des opérations qui vont opposer l'armée rouge (Sud) du Général Chomer à l'armée bleue (nord) du général Pau - Carte postale d'époque.

Terrain de campagne aménagé pour l'aviation militaire lors des grandes manoeuvres du Sud-Ouest de septembre 1913 - Au premier plan, les camions ateliers et les remorques pour faire les pleins essence - A cette époque, le carburant avion était conditionné en bidons métalliques - Les tentes alignées sur le coté droit servent à abriter les avions (un avion par tente) - Origine agence M.Rol en vente sur le Site Internet "Past to Present".

Le centre d'aviation du polygone de Toulouse pendant les Grandes manoeuvres du Sud-Ouest - Dans le fond, on apercoit les Bréguet U1 de l'escadrille BR 17 - Au
premier plan, les tentes avions de type B et les voitures atelier de réparation Clément Bayard - Photo du 10 septembre 1913 - Origine agence M.Rol en vente sur le Site Internet "Past to Present".

Photo prise à l'opposé de la photo précédente - Alignement des Bréguet U 3 de l'escadrille BR 17 - Photo du 10 septembre 1913 - Photo Sahara.

Les trois biplans Breguet U 3 de l’escadrille BR 17 au Polygone de Toulouse, parti rouge, septembre 1913 - Photo Archives départementales de Haute Garonne.
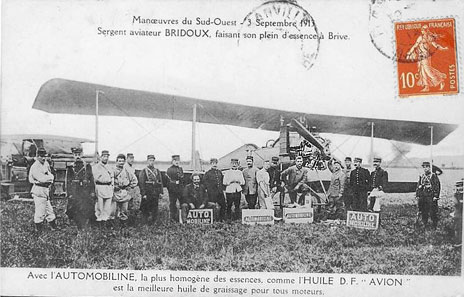
Breguet U 3 piloté par le Sgt Bridoux de l'escadrille BR 17 - Carte postale publicitaire d'époque.

Blériot XI de l’escadrille BL 3 à Saint Clar (Gers), parti bleu, septembre 1913 - Photo Archives départementales de Haute Garonne.

Malgré la présence d’un périmètre de sécurité, nombre de curieux inspectent les appareils Voisin type L du parti rouge posés au Polygone de Toulouse le 4 septembre 1913 - Photo Archives départementales de Haute Garonne.

Voisin type L à l’Isle Jourdain (Gers), parti rouge, septembre 1913 - A droite sur la photo, le chef de l’escadrille, le capitaine Estirac - Photo Archives départementales de Haute Garonne.

Superbe vue de deux biplans Voisin type L à l’Isle Jourdain (Gers), septembre 1913 - Les grandes manœuvres démonteront la fiabilité de ces appareils dont les dernières versions équiperont encore les escadrilles de l’Armée française à la fin de la première guerre mondiale - Photo Archives départementales de Haute Garonne.

Maurice Farman MF 7 de l'escadrille MF 5 à St Clar (Gers), parti bleu, septembre 1913 - Notez les roues de secours fixées au train d’atterrissage - Photo Archives départementales de Haute Garonne.

Biplan Henri Farman HF 20 de l'escadrille HF 19 du parti bleu à St Clar (Gers), septembre 1913 - Photo Archives départementales de Haute Garonne.

Montage à Agen d'un Henri Farman HF 20 arrivé en caisses pendant les grandes manoeuvres du Sud-Ouest, le 9 septembre 1913 - Appartenant à l'escadrille HF 19, il est assemblé par les monteurs avions - Origine agence M.Rol en vente sur le Site Internet "Past to Present".
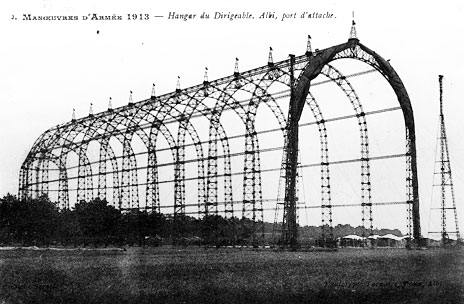
Construction du hangar qui sera utilisé par le dirigeable "Adjudant Vincenot" - Terrain d'Albi - Parti rouge - Septembre 1913 - Carte postale d'époque.
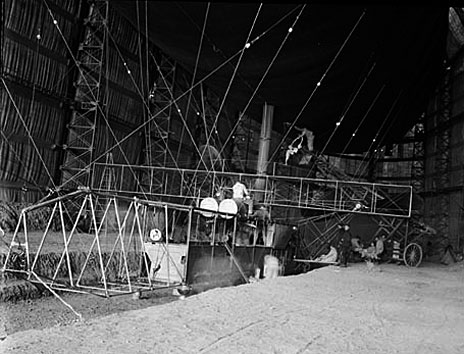
Le dirigeable "Adjudant Vincenot" dans son hangar à Albi, parti rouge, septembre 1913 - Photo Archives départementales de Haute Garonne.

Vue rapprochée du hangar du dirigeable "Adjudant Vincenot", Albi, septembre 1913 - Photo Archives départementales de Haute Garonne.

Le parc des camions ateliers d'une escadrille participant aux grandes manoeuvres du Sud-Ouest, en septembre 1913 - Origine agence M.Rol en vente sur le Site Internet "Past to Present"

Gros plan des camions atelier de la photo supérieure - Remarquez les différentes inscriptions : "Aviation militaire" à l'avant devant le radiateur "Aviation militaire - escadrille n° x - Camion atelier" - Origine agence M.Rol en vente sur le Site Internet "Past to Present".

Camion d'aviation participant aux grandes manoeuvres du Sud-Ouest de 1913 - Avec toute cette série de véhicules spécialisés, comme les camions ateliers, les camions de transport de personnel et les remorques tractée pour avions, les escadrilles deviennent de plus en plus autonomes. Tous ces matériels vont prouver leur valeur opérationnelle lors de l'offensive allemande de 1914 - Les escadrilles françaises vont ainsi pouvoir coller à la ligne de front en changeant de terrains à chaque fois que cela est nécessaire - Sans ces équipements, rien n'aurait été possible - Origine agence M.Rol en vente sur le Site Internet "Past to Present"

Camion atelier au Polygone de Toulouse, parti rouge, septembre 1913 - A l’arrière plan, un monoplan Deperdussin type T de l'escadrille D 6 en réparation - Photo Archives départementales de Haute Garonne.
Le Sapeur Pierre Chanteloup fait un looping :
Le 21 septembre, le sapeur Pierre Chanteloup, affecté au centre de Douai-la-Brayelle, a effectué un looping aux commandes d'un biplan. Il s'agit d'une manoeuvre un peu différente de celle exécutée par Pégoud sur le terrain de Buc. A 1.000 m, Chanteloup pencha son biplan sur le côté, les ailes perpendiculaires au sol. A ce moment, l'avion se redressa, le train d'atterrissage en l'air. Il plana quelques secondes dans cette position puis reprit sa position de vol normal.
Mort du Ltt Jean Cazès à Mogador :
Le 22 septembre, un Blériot XI-2, en provenance de Casablanca et après une escale technique à Safi, s'est écrasé en mer au large de Mogador, à 300 mètres du rivage. Les secours, arrivés sur place, ont pu sauver le passager, un sapeur du génie. Le pilote, le Ltt Jean Cazés avait disparu, sans doute emporté par son appareil qui a coulé. Le lendemain, le Ltt Van den Vaero, arrivé de Casablanca, a survolé la zone de l'accident pour tenter de retrouver le corps de son camarade. Malheureusement, en vain ! Il faudra attendre le 27 octobre pour que la mer rende le corps du pilote. Il sera retrouvé à l'embouchure de l'Oued-Sidzi, à 20 km au Sud de Mogador.
Retour du dirigeable "Adjudant-Vincenot" :
Le 23 septembre, le dirigeable "Adjudant-Vincenot" a quitté Albi pour rejoindre Issy-les-Moulineaux, première étape de son périple de retour vers Toul. Il a effectué le trajet en 10h30 de vol.
Mort du Ltt Auguste Soulleillan à Oudjda :
Le 24 septembre, après un vol dans les environs d'Oudjda, le Ltt Auguste Soulleillan se présentait en vol plané pour l'atterrissage. C'est alors que son monoplan s'écrasa d'une hauteur de 50 mètres. Les secours, arrivés sur place, ne purent que constater la mort intantanée de l'officier, tué par une grave fracture du crâne. Auguste Louis Marie Soulleillan, qui avait été nommé lieutenant, le 12 mai 1910, appartenait au 13ème régiment de chasseurs à cheval.

Ltt Auguste Soulleillan du 13ème régiment de chasseurs à cheval, a été tué lors d'un accident d'avion à Oudjda, le 24 septembre 1913 - Photo collection Christian Tollet que je remercie pour son aide.
Inauguration du terrain d'aviation de Dunkerque :
Le 28 septembre, le champ d'aviation et les hangars, financés par la souscription lançée par la fédération des sociétés des anciens militaires et 65 communes de l'arrondissement, ont été inaugurés à Saint-Pol-sur-Mer en présence d'une foule de 40.000 personnes.
Crise des vocations des officiers pour l'aéronautique militaire :
En 1911 et 1912, près de 3000 officiers demandaient à être affectés au sein de l'aéronautique militaire. En 1913, c'est à peine si 30 demandes ont été recensées. L'une des raisons a cette crise des vocations est le manque d'organisation de l'aéronautique militaire. De ce côté, les choses s'arrangent et tendent à disparaitre. L'autre cause, plus profonde, réside dans le mécontentement des pilotes qui se trouvent insuffisamment payés par rapport aux risques courus.
En plus de sa solde ordinaire, un officier aviateur touche une indemnité de 5 francs par jour lorsqu'il est élève pilote. Quand il a obtenu son brevet de pilote militaire, beaucoup plus difficile à obtenir que le brevet civil de l'Aéroclub de France, il touche une indemnité de 10 francs par jour. Tous les semestres, il subira deux épreuves d'aviation pour maintenir son entrainement. Pour les sous-officiers, la situation est encore plus difficile.
Il faut préciser que la proportion des officiers aviateurs qui ont payé de leur vie leur affectation au sein de l'aéronautique militaire est très importante. Dans certains centres d'aviation militaire, elle atteint 25 %. Cette proportion serait encore plus élevée en cas de guerre.
Il devient nécessaire de proportionner les avantages assurés aux pilotes militaires aux risques exceptionnels qu'ils courent dans l'excercice de leur mission.
Vols des dirigeables Chalais-Meudon "Fleurus" et Astra "Conté" :
Le 30 septembre, le dirigeable "Fleurus", fabriqué aux ateliers militaires de Chalais-Meudon, après être sorti de son hangar du terrain de Saint-Cyr, a évolué au-dessus de Paris pendant 2 heures. Il a croisé le dirigeable "Conté", fabriqué en toile Hutchinson, qui venait du terrain de d'Issy-les-Moulineaux. Ensemble, ils ont volé un certain temps. L'Astra "Conté" avait à bord 12 passagers en plus de l'équipage. Il s'agissait des membres de la commision militaire de réception, le colonel Voyer, le commandant Fleury, le capitaine Martin-Lagarde. Le "Conté" a été chronométré à 65,75 km/h. Il est le plus rapide des dirigeables français.
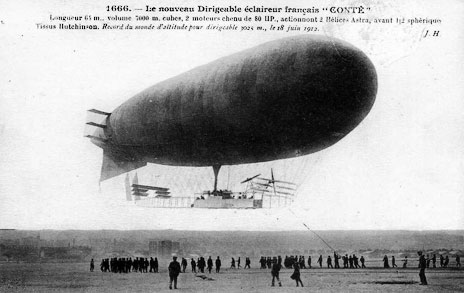
Dirigeable Astra "Conté" - Longueur 65 m - Volume de 7000 m3 - 2 moteurs Chenu de 80 ch actionnant deux hélices Astra - Ce dirigeable a battu le record du monde d'altitude pour dirigeable de 3025 m, le 18 juin 1912 - Carte postale d'époque.
Accident du Sgt Brémont à Pau :
Le 30 septembre, un monoplan, piloté par le Sgt Brémont, s'est écrasé sur le terrain militaire de Pau, alors qu'il volait encore à 20 mètres d'altitude. Evacué sans connaisssance, il a été relevé avec une fracture à la jambe et de multiples contusions. Ce pilote, originaire de Montpellier, est âgé de 32 ans.
Le colonel H. Romazzotti nommé Inspecteur permanent de l'aéronautique militaire :
Le 1er octobre, le colonel André Romazzotti a été nommé inspecteur permanent de l'aéronautique militaire par intérim. Il remplace dans cette fonction, le général de brigade Edouard Hirschauer démissionnaire. Auparavant, le colonel Romazzotti était adjoint du général. La direction de l'aéronautique militaire, au ministère de la Guerre, avait été confiée au général Bernard, le 24 août. Le lieutenant-colonel Caron du 30ème régiment d'artillerie est nommé adjoint du colonel Romazotti.
Les capitaines Millot et Delmar (artillerie) sont détachés au service du contrôle des matériels aériens.
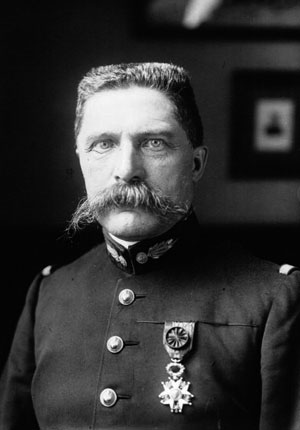
Le général de brigade Edouard Hirschauer quitte le poste d'inspecteur permanent de l'Aéronautique militaire, le 24 septembre 1913 - Cette photo datée de 1912 le montre alors qu'il était encore colonel - Photo Agence Meurisse archivée à la Grande Bibliothèque de France et mise en ligne par le site "Gallica".
* Général de division Auguste Edouard Hirschauer - Né le 16 juin 1857 à Saint-Avold (Moselle) - Fils de Charles Edouard Hirschauer et de Julie Dufour - A opté pour la nationalité française à Calais, le 8 juin 1872 - Reçu à l'école Polytechnique en 1876 - Marié avec Marie Claire Elisabeth Joséphine Goussel, le 9 octobre 1883 - 4 enfants, 3 garçons et une fille - Sous-lieutenant, élève de l'école d'application de l'artillerie et du génie, le 1er octobre 1878 - Nommé Lieutenant de 2ème au 1er régiment du Génie de Versailles, le 1er octobre 1880 - Embarqué à Marseille pour l'Algérie, le 30 juillet 1881 - Embarqué à Oran, le 2 août 1881 - Embarqué à Méchéria, le 13 août 1881 - A fait partie des colonnes appelées à réprimer les mouvements rebelles sur le territoire algérien du 13 août au 6 octobre 1881 - débarqué à Marseille, le 5 décembre 1881 - Médaille Coloniale avec agrafe "Algérie" - Lieutenant en 1er, le 9 novembre 1881 - Nommé Capitaine en second, le 4 octobre 1883 - Capitaine de l'Etat-major particulier du Génie à Lille, le 11 novembre 1883 - Profession professeur adjoint de l'école spéciale militaire de St-Cyr, le 29 septembre 1886 - A suivi les cours de l'école supérieure du 1er novembre 1889 au 3 novembre 1891 - Capitaine en 1er de l'Etat-Major du Génie, le 18 octobre 1889 - Stagiaire à l'état-major de l'armée, le 11 novembre 1891 - 3ème bureau de l'état-major de l'armée, le 26 décembre 1893 - Officier d'ordonnance du général Raoul Le Mouton de Boisdeffre, chef d'état-major général de l'armée, le 12 décembre 1895 - Chevalier de la Légion d'Honneur, le 30 décembre 1895 - Autorisé à dirigeur des ascensions en ballon libre, le 3 mars 1898 - Nommé Chef de Bataillon, le 16 avril 1898 - Chef de cabinet du chef général de l'armée, le 26 juillet 1898 - Etablissement central d'aérostation militaire à Chalais-Meudon, le 8 décembre 1898 - Affecté au 1er régiment du Génie (aérostiers) à Versailles, le 1er avril 1901 - Nommé Lieutenant-colonel, le 24 juin 1905 - Affecté au 3ème régiment du Génie d'Arras, le 11 juillet 1905 - Officier de la Légion d'Honneur, le 31 décembre 1907 - Stagiaire au 33ème régiment d'infanterie, el 1er janvier 1909 - Directeur du Génie à Lille, le 26 février 1909 - Nommé Colonel, le 24 décembre 1909 - Commandement des troupes d'aérostation, le 30 avril 1910 - Inspecteur permanent de l'aéronautique militaire de Paris du 25 avril 1912 au 24 septembre 1913 - Nommé Général de Brigade, commandant de la brigade du 1er régiment du Génie et le département de Seine-et-Oise, le 24 décembre 1912 - Commandeur de la Légion d'honneur, le 3 septembre 1913 - Commandant de la brigade des 5ème et 8ème régiment du Génie, le 15 novembre 1913 - Commandant le Génie de la région Sud-Ouest de Paris, le 2 août 1914 - Chef d'état-major des défenses du camp retranché de Paris, le 28 août 1914 - Directeur du service aéronautique au Ministère de la Guerre, le 8 octobre 1914 - Commandant de la 29ème brigade d'infanterie, le 22 septembre 1915 - Blessé par un éclat d'obus au pied gauche au cours d'une attaque de tranchées à Mahure (51), le 9 octobre 1915 - Commandant de la 63ème division d'infanterie, le 3 janvier 1916 - Promu Général de division, le 25 mai 1916 - Commandant le 18ème corps d'armée, le 20 juin 1916 - Grand Officier de la Légion d'Honneur et Croix de Guerre, le 10 juillet 1917 - Commandant le 9ème corps d'armée, le 22 août 1917- Commandant de la 2ème armée, le 11 décembre 1917 - Gouverneur de Strasbourg du 22 novembre 1918 au 22 ocotbre 1919 - Commandant supérieur du territoire d'Alsace du 22 février 1918 au 22 octobre 1919 - Placé en réserve, le 16 juin 1919 - Sénateur du département de la Moselle du 11 janvier 1920 au 27 décembre 1943 - Grand Croix de la Légion d'Honneur, le 16 juin 1920 - Domicilié 7, passage Pilatre de Rozier à Versailles (Seine et Oise) - Médaille Militaire, le 30 décembre 1931 - Remise devant les troupes du 6ème corps d'armée à Metz - Décédé à Versailles , le 27 décembre 1943 - Auguste Edouard Hirschauer repose au cimetière de Montparnasse à Paris (75).
Quatre citations à l'ordre de l'armée : le 13 juillet 1915 par l'armée de Paris - le 21 octobre 1915 par la IIème armée - le 31 décembre 1915 par la 15ème division - le 13 juillet 1917.

Les officiers affectés à l'état-major de l'aéronautique militaire en 1912 - Au premier plan, da gauche à droite Capitaine Do, Colonel Hirschauer, Lieutenant-colonel Bouttiaux et debouts au second plan : Capitaine Marconnet, Capitaine de Goys, Capitaine Marie, Lieutenant Peraldo, Officier d'administration de 1ère classe Durand - Photo Agence Meurisse archivée à la Grande Bibliothèque de France et mise en ligne par le site "Gallica".

Le colonel André Romazzotti devient inspecteur permanent de l'Aéronautique militaire, le 1er octobre 1913 - Photo "La revue aérienne" d'octobre 1913.
* Colonel André Romazzotti - Né le 26 juin 1859 à Obermichelbach (Haut-Rhin) - Fils de Paul Romazzotti et de Marie Clarisse Gorsse - Domiciliés rue d'Amsterdam à Paris 8ème arrondissement - A choisit la nationalité française à Strasbourg, le 10 août 1872 - Engagé volontaire, le 27 octobre 1877 - Elève de l'école spéciale militaire de St-Cyr, le 30 octobre 1877 (206 sur 340) - Sous-lieutenant à l'école d'application de cavalerie, le 1er octobre 1879 - A suivi les cours de l'école de cavalerie comme élève officier du 1er novembre 1879 au 31 août 1880 (34 sur 86) - Affecté au 13ème régiment de Chasseurs, le 9 septembre 1880 - Corps expéditionnaire de Tunisie du 14 avril 1881 au 12 juin 1882 - Algérie du 13 juin 1882 au 28 janvier 1884 - Nommé Lieutenant, le 20 décembre 1883 - Marié à Jeanne Marie Emma Brochot, le 26 octobre 1885 - Six enfants, 3 garçons et 3 filles - Affecté au 14ème régiment de Chasseurs, le 28 octobre 1886 - A suivi les cours de l'école de cavalerie comme officier d'instruction du 20 octobre 1887 au 31 août 1888 (10 sur 36) - Affecté comme officier d'intendance au 6ème régiment de Chasseurs, le 29 mars 1889 - Nommé Capitaine instructeur du 6ème régiment de Chasseurs, le 12 juillet 1890 - Nommé Capitaine en second, le 7 octobre 1892 - Ecole supérieure de Guerre du 1er novembre 1892 au 31 octobre 1894 - Affecté au 14ème régiment de Chasseurs, le 2 octobre 1893 - Médaille Coloniale agrafe "Algérie", le 15 novembre 1894 - Stagiaire à l'état-major de la 5ème division de cavalerie, le 1er février 1895 - Officier d'ordonnance de l'état-major de la 13ème brigade de cavalerie, le 17 mars 1897 - Chevalier de la Légion d'Honneur, le 28 décembre 1897 - Autorisé à diriger des ascensions en ballon libre, le 23 mars 1898 - Commotion cérébrale et contusions multiples suite à une chute de cheval, le 3 août 1900 - Nommé Chef d'escadron du 3ème régiment de Hussards, le 16 mars 1901 - Etat-major du 10ème corps d'armée, le 12 ocotbre 1903 - Lieutenant-colonel du 20ème régiment de Dragons, le 27 septembre 1906 - Colonel du 24ème régiment de Dragons, le 24 juin 1910 - Adjoint à l'inspecteur permanent de l'aéronautique militaire, le 24 juin 1912 - Inspecteur permanent par intérim de l'aéronautique militaire, le 1er octobre 1913 - Officier de la Légion d'Honneur, le 31 décembre 1913 - Décédé dans le département des Côtes du Nord (22), le 18 août 1923.
Mort du MdL Hurtard à Cézannes :
Le 4 octobre, le MdL Hurtard venait de décoller, aux commandes d'un monoplan, du terrain de Sézanne (près d'Epernay), en compagnie du sapeur Morin, à destination du terrain de Reims. Pris dans une rafale, l'avion fut déséquilibré et s'écrasa au sol où il se disloqua entièrement. Les secours arrivés sur place trouvèrent le pilote tué sur le coup, écrasé par le moteur et le passager, inanimé avec une jambe brisée et de graves blessures sur le corps.

Les restes du monoplan de l'équipage Hurtard / Morin, tombé dans un champ dans les environs de Cézannes, le 4 octobre 1913 - Carte postale d'époque.
Mort du Sapeur Jean-Pierre Laverlochère à Chaumont :
Le 4 octobre, un Deperdussin à moteur Gnôme piloté par le sapeur Jean-Pierre Laverlochère, détaché du 3ème régiment du Génie, vire brutalement, pique et s'écrase entre Perthes et Lonchampt. Le pilote, victime d'une fracture du crâne, est décédé. Il se rendait à la fête d'aviation de Chaumont et appartenait au centre d'aviation de Reims. Le pilote repose au cimetière de Pont-Evêque (Isère).

Sapeur Jean-Pierre Laverlochère - Né le 17 septembre 1891 à Pont-Evèque (Isère) - Fils de Jean-Baptiste Laverlochère et d'Anne Decourt - Profession avant guerre Mécanicien ajusteur - Domicilié au 106, Avenue Batignolles à St-Ouen - Classe 1911 - Recrutement de Vienne (Isère) sous le matricule n° 966 - Service militaire aux troupes aéronautiques de Lyon, à compter du 8 octobre 1912 - Brevet de pilote civil n° 1313 décerné par l'Aéroclub de France, le 2 mai 1913 - Affecté au centre d'aviation militaire de Reims - Brevet de pilote militaire n° 316 obtenu le 11 juillet 1913 - Nommé Caporal, le 1er août 1913 - Tué au cours d'un accident aérien entre Perthes et Lonchampt (Haute-Marne), le 4 octobre 1913 - Jean Pierre Laverlochère repose dans le cimetière de Pont-Evêque (Isère) - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France - Sources : Fiche matricule du département de l'Isère - Liste des brevets décernés par l'Aéroclub de France - Liste des brevets militaires - Dernière mise à jour : 26 novembre 2017.
Inauguration du terrain de Joigny :
Le 5 octobre, le hangar érigé sur le terrain d'aviation de Joigny grâce à la souscription publique, a été inauguré par les officiels dont le Sénateur Reymond qui est arrivé aux commandes d'un monoplan. L'enseigne de Vaisseau Marcel Destrem et le Ltt Bonin ont exécuté des vols de démonstration.
Le dirigeable "Fleurus" rejoint Maubeuge :
Le 6 octobre, le dirigeable "Fleurus", piloté par le Ltt Hennequin, accompagné de 2 élèves pilotes et 4 mécaniciens, est parti de Saint-Cyr pour Maubeuge. Le 16, Il évoluera au-dessus d'Avesnes, Etroeungt et le Nouvion.
Inauguration du terrain de Longwy :
Le 10 octobre, le hangar érigé sur le terrain d'aviation de Longwy grâce à la souscription publique, a été inauguré par M. Albert Lebrun, député de la circonscription de Briey dont Longwy fait partie et ancien ministre des colonies et de la Guerre.
Inauguration du monument en hommage au Ltt de Boncour :
Le 12 octobre, inauguration du monument en hommage au Ltt Antoine de Boncour à Laimont (55). Cet officier s'est tué à cet endroit, le 13 avril 1912.

Monument en hommage au Ltt Antoine de Boncour sur la commune de Laimont (55) - Carte postale collection
Gilles Gaspérini que je remercie pour son aide.

Inauguration du monument en hommage au Ltt Antoine de Boncour sur la commune de Laimont (55), le 12 octobre 1913 - Carte postale collection Gilles Gaspérini que je remercie pour son aide.
Accident du Cne François de Vergnette de Lamotte :
Le 18 octobre, le Cne François de Vergnette de Lamotte, qui arrivait de Versailles aux commandes d'un monoplan, passait à la verticale de la route nationale de Troyes, au niveau du village d'Aix. Soudain, alors qu'il était encore à 700 mètres altitude, le moteur tomba en panne. L'appareil piqua du nez et s'écrasa au milieu des champs, près de la ferme de Changey. L'avion a été retrouvé, retourné avec le pilote coincé en dessous. Il souffrait de blessures à la tête et se plaignait de douleurs aux oreilles, aux bras et aux jambes. Le capitaine fut transporté à la ferme de Changey, où les docteurs Lamblin et Chauvenet lui apportèrent les premiers soins. Malgré ses multiples blessures, l'officier se remettra sur pieds.
Mort du Ltt Gabriel Garnier et du Sapeur Jenrot :
Le 20 octobre, le Ltt Gabriel Garnier, accompagné de son mécanicien, le sapeur Jenrot, était chargé de la prise en compte à Buc et du convoyage d'un avion biplace affecté au centre d'Epinal. Après avoir décollé, le moteur eut plusieurs ratés au-dessus du village de Prez-sous-Lafauche, obligeant le pilote à tenter un atterrissage en campagne. Le Ltt Garnier entama une approche en vol plané et qu'il était encore à une altitude de 100 mètres, l'avion s'inclina soudain et s'écrasa dans un champ. A l'arrivée des témoins, les deux hommes avaient cessé de vivre. L'enquête n'a pas permis de démontrer si l'accident était dû au pilote qui pilotait cet appareil pour la première fois ou par la nature du terrain choisi pour atterrir.
Mort du Caporal Guy Loyne d'Autroche :
Le 20 octobre, le caporal Guy Loyne d'Autroche, affecté au centre d'épinal, a été victime d'un accident d'aviation sur le terrain de Dogneville. Alors qu'il tentait de boucler la bouche (looping), il a perdu les commandes de son appareil qui s'est écrasé d'une hauteur de 500 mètres. L'aviateur a été tué sur le coup.
Coup de vent destructeur sur Mâcon :
Le 20 octobre, deux avions, en provenance de Lyon, avaient atterri sur la prairie de Saint-Clément près de Mâcon. Le lendemain matin, un gros coup de vent balaye la région et endommage gravement le biplan "Ville-deDijon" du MdL Pierre Clément, malgré les efforts des soldats sur place qui assuraient sa garde et qui l'avaient attaché au sol. Par contre, l'autre appareil, le monoplan du Ltt Paul Bousquet, fut sauvegardé.
Accident du Sapeur Maurice Dubois :
Le 23 octobre, le sapeur Maurice Dubois, affecté au centre d'aviation militaire de Reims, décolle de Fargniers pour rejoindre Reims. Trop tôt après le décollage, il vire brusquement. L'aile gauche heurte le sol et l'avion s'écrase. Le pilote est transporté avec une commotion cérébrale chez le maire du village, M. Harondelle. Dubois se remettra de ses blessures.
Réception de 6 Blériot XI-2 à Buc :
Le 24 octobre, la commision de réception de l'aéronautique militaire a assité à la réception de 6 Blériot XI-2, biplaces en tandem sur l'aérodrome de Buc. Ils font partie d'une commande de 15 appareils du même type. Toutes les épreuves imposées par le cahier des charges ont été réalisées avec succès.
L'Aéro-Cible Michelin pour le Ltt Adolphe Varcin :
Le 24 octobre, le jury de l'Aéro-Cible Michelin s'est réuni dans les locaux de l'Aéroclub de France, sous la présidence de M. R. Soreau.
Le jury se composait de :
Cdt Dorand, Cdt Raibaud, Cne Robert : délégués du ministre de la Guerre.
M. Soreau, A. Michelin, Paul Tissandier, E. Zens : délégués de l'Aéroclub de France.
Le prix de 50.000 francs a été décerné au Ltt Varcin pour 13 projectiles placés dans la cible sur 15. Deuxième et 3ème prix ex-oequo pour le Cne Leclerc et le marquis de Lareinty-Tholozan (7 projectiles) qui reçoivent chacun 6.250 francs. Quatrième prix pour M. Gaubert (6 projectiles) qui reçoit 3.000 francs. Les 5ème et 6ème prix n'ont pas été attribués.
Inauguration du terrain de Chambéry :
Le 26 octobre, le département de la Savoie, qui avait offert à l'armée un avion au titre de la souscription nationale, disposaient encore de fonds. Le comité décida la construction d'un hangar pour avions, sur le vaste champ de manoeuvres de Challes-les-Eaux. La ville de Chambéry offrit le terrain. Ce sont ces installations qui furent inaugurés par le préfet de la Savoie, de généraux, du maire de Champigny. Le Sapeur Louis Blot était venu aux commandes du Henri Farman HF 20 n° 91 offert à l'aéronautique militaire au titre de cette souscription.
Inauguration du terrain de Neufchâteau :
Le 27 octobre, le sénateur Reymond a inauguré le hangar d'aviation de Neufchâteau.
Mort du MdL Joseph Canal sur le terrain de Reims :
Le 28 octobre, le MdL Joseph Canal, affecté au centre d'aviation militaire de Reims, réalisait un vol d'entraînement au-dessus du terrain, aux commandes d'un monoplan. Alors qu'il était à 100 mètres d'altitude, les témoins vinrent son appareil entamer sa descente, entamer 3 spirales pour se rapprocher du sol. A la 4ème, alors qu'il était encore à 50 m d'altitude et en trop faible vitesse, l'avion percuta le sol presque à la verticale. Le monoplan rebondit deux fois en se retournant. Les témoins accourus sur place trouvèrent l'avion complétement broyé, avec le moteur enfoui dans le sol. Le pilote, qui respirait encore quand on le dégagea, avait les membres brisés, une jambe détachée et la colonne vertébrale fracturée en deux endroits. Il succomba très peu de temps après.

MdL Joseph Canal du 3ème régiment d'artillerie de Castres, affecté au centre d'aviation militaire de Reims - Brevet de pilote militaire n° 211 obtenu le 15 février 1913 - Tué au cours d'un accident aérien sur le terrain d'aviation militaire de Reims, le 28 octobre 1913 - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
L'Aéro-cible Michelin :
Le 5 novembre, la commission de l'Aéroclub de France a procédé à la clôture des engagements pour le prix de 25.000 francs de l'Aéro-cible Michelin. Les engagés sont MM. Coursin, Fourny, Gaubert, le Cne Paul Leclerc, le Ltt Jean Sallier, le Sgt René Vandelle. Les tirs auront lieu au camp de Châlons, du 12 au 20 novembre. Ils seront effectués d'une altitude d'au moins 1.000 mètres. Le but sera constitué par un cercle de 25 mètres de rayon tracé au sol. Les projectiles seront des obus de 220 mm et d'un poids unitaire de 22 kg.
Mort du Cne Denis de Lagarde :
Le 12 novembre, le Cne Denis de Lagarde du 37ème régiment d'artillerie, affecté au centre d'aviation militaire de Reims, devait effectuer des essais de TSF à partir de son monoplan sur le terrain de Villacoublay. Après avoir effectué le trajet Reims-Villacoublay sans problème, il se présenta pour atterrir, moteur coupé comme c'était l'habitude à cette époque. C'est alors d'un coup de vent plaqua l'avion dont les roues touchèrent un arbre, le destabilisant complétement. L'avion se retourna, tomba sur le toit d'un hangar pour s'écraser finalement d'une hauteur de 7 mètres. Le Cne de Lagarde, 32 ans, fut tué sur le coup. Son corps a été transporté à l'hôpital militaire de Versailles. L'enquête sur cet accident a été réalité par le colonel Bouttiaux. Il a été inhumé au cimetière parisien du Père Lachaise.
Mort du Ltt Fernand Briault et du sapeur Emmanuel Brouillard :
Le 26 novembre, un biplan militaire venant de St-Cyr à destination de Mourmelon, avec un équipage de deux hommes, s'est écrasé au lieu dit "Oliveux", sur le territoire de la commune de Chantemerle, à 500 mètres de la ferme des Noblots. Victime d'une panne en vol, le pilote a tenté un atterrissage en campagne. D'après les voisins, l'avion a dû toucher un bouquet d'arbres et s'être retourné. Après l'impact, le réservoir d'essence a explosé et a embrasé les alentours. Les deux membres d'équipage, le Ltt Fernand Briault et le Sapeur Emmanuel Brouillard, avaient certainement été tués sur le coup. Leurs corps, qui ont été transportés à l'hospice de Sézanne, ont été presque entièrement carbonisés et leur identification faite grâce des éléments de leurs uniformes (boutons, chemises, porte-monnaie).

Ltt Fernand Briault - Né en Bretagne - Marié et père d'un enfant - Domicilié 62, avenue de Paris à Versailles - Ecole d'artillerie de Versailles - Affecté au 8ème régiment d'artillerie et détaché au centre d'aviation de Saint-Cyr - Passé à l'aviation, le 29 mai 1912 - Brevet de l'aéroclub de France obtenu le 9 juillet 1912 - Brevet de pilote militaire n° 177 obtenu le 7 novembre 1912 - Tué au cours d'un accident aérien au lieu dit "Oliveux", sur le territoire de la commune de Chantemerle, le 26 novembre 1913 - Il faisait équipage avec le sapeur Emmanuel Brouillard qui a également perdu la vie - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
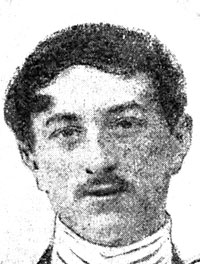
Sapeur Emmanuel Brouillard - Originaire de Ploërmel - Service militaire comme mécanicien du 1er groupe aéronautique du centre d'aviation militaire de Saint-Cyr - Mécanicien du Ltt Fernand Briault - Tué au cours d'un accident aérien au lieu dit "Oliveux", sur le territoire de la commune de Chantemerle, le 26 novembre 1916 - Il faisait équipage avec le Ltt Fernand Briault qui a également perdu la vie - Il repose au cimetière de Ploërmel - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
Création des groupes d'aviation :
Le 29 novembre 1913, trois groupes d'aviation sont créés, respectivement :
- 1er groupe d'aviation à Lyon (avec un transfert prévu sur Dijon-Longvic dès que les travaux d'installation sur place seront terminés),
- 2ème groupe d'aviation à Reims,
- 3ème groupe d'aviation à Lyon.
Il s'agit d'un correctif à l'organisation de l'aéronautique militaire du 22 avril 1913.
Mutations au sein de l'Aéronautique militaire :
Le 5 décembre, par décision ministérielle les mutations suivantes ont été prononcées dans l'aéronautique militaire :
- Colonel V. P. Bouttiaux, issu du Génie, commandant le 1er groupe d'aéronautique à Versailles, a été désigné pour commander le 1er groupe d'aviation à Lyon.
- Colonel A. E. Caron, issu de l'artillerie, a été nommé adjoint à l'inspecteur permanent de l'aéronautique militaire.
- Le LcL J. M. J. Ganter, issu du 74ème régiment d'infanterie à Rouen, a été désigné pour commander le 2ème groupe d'aviation de Reims en remplacement du LcL Breton.
- Le Cdt J. S. Voyer, issu du Génie, directeur du matériel aéronautique militaire à Chalais-Meudon, a été désigné pour commander le 1er groupe d'aérostation à Versailles
- Le Cdt C. E. Richard, issu du Génie, chef du service aéronautique de Versailles-St-Cyr a été désigné pour commander le port d'attache de Versailles-Saint-Cyr, en remplacement du Cne Izard.
- Cdt C. H. Lindecker, issu du Génie, commandant en second du 2ème groupe d'aéronautique, chef du service aéronautique à Reims, a été désigné pour commander en second le 2ème groupe d'aviation à Reims.
- Le Cne Albert Octave Etevé, issu du Génie, chef du centre d'aviation militaire de St-Cyr, a été affecté à l'établissement central du matériel aéronautique militaire (aviation) à Clalais-Meudon.
- Le Cne Albert Joseph Lucas, issu de l'infanterie coloniale, du centre d'aviation militaire de Buc, a été désigner pour commander le centre d'aviation de St-Cyr.
- Le Cne L. Néant, issu du Génie, chef du service aéronautique à Epinal, a été désigné pour commander le port d'attache d'Epinal.
- Le Cne A. A. Renaux, issu du Génie, chef du service aéronautique à Belfort, a été désigné pour commander le port d'attache de Belfort, en remplacement du Cne de Chabot, issu du Train des équipages militaires.
- Le Cne Charles Schneegans, issu de l'infanterie coloniale, chef du service aéronautique à Toul, a été désigné pour commander le centre d'aviation militaire de Toul, en remplacement du Cne Bertin, issu de l'infanterie coloniale.
- Le Cne Alphonse Roisin, issu de l'infanterie, au 2ème groupe d'aéronautique à Reims, a été désigné pour commander le centre d'aviation du camp de Châlons, en remplacement du Cne Badet, issu de l'artilerie.
- Le Cne G. A. Delassus, issu du Génie, chef du service aéronautique à Verdun, a été désigné pour commander le port d'attache de Verdun.
- Le Cne R. M. E. Yence, issu de l'artillerie, chef du service aéronautique à Maubeuge, a été désigné pour commander le centre d'aviation militaire de Maubeuge.
- Le Cne A. J. L. Balensi, issu du Génie, adjoint au chef du service aéronautique à Reims, a été désigné pour commander le port d'attache de Maubeuge.
- Le Cne L. N. Guillabert, issu de l'infanterie, au 1er groupe d'aéronautique de Villacoublay, a été désigné pour commander le centre d'aviation de Reims, en remplacement du Cne Laborde, issu de l'artillerie.
- Le Cne M. F. J. Legardeur, issu de l'infanterie, au 3ème groupe d'aéronautique, compagnie d'aviation à Lyon, a été désigné pour commander le centre d'aviation de Lyon, en remplacement du Cne Carlin, issu de l'infanterie coloniale.
- Le Cne P. L. Bousquet, issu de l'infanterie coloniale, adjoint au chef du centre aéronautique de Lyon, a été affecté à la compagnie d'aviation de Lyon.
- Le Cne M. J. de Chaunac-Lanzac, issu de l'artillerie coloniale, chef du service de l'aviation au Maroc, a été remis à la disposition de son arme.
- Le Ltt P. L. Faure, issu du 5ème régiment d'artillerie, a été affecté au Laboratoire d'aviation militaire de Vincennes.
Photo du Cne Louis Bertin
* Cne Louis Xavier Joseph Joachim Bertin - Né le 20 mars 1876 à Vire (Calvados) - Fils d'Aimable Chrysostome Pascal Bertin (principal de collège) et de Laure Emilie Lequien - Domiciliés à Issoudun (Indre) - Classe 1896 - Recrutement de Châteauroux (Indre) sous le matricule n° 709 - Engagé volontaire pour quatre ans, à compter du 15 décembre 1894 - Affecté au 104ème régiment d'infanterie, le 15 décembre 1894 - Affecté au 117ème régiment d'infanterie, le 29 septembre 1896 - Admis à l'école spéciale militaire du 30 octobre 1897 au 20 août 1898 - Nommé Sous-lieutenant et affecté au 131ème régiment d'infanterie, le 1er octobre 1899 - Affecté au 6ème régiment d'infanterie de marine, le 19 octobre 1900 - Affecté au 6ème régiment d'infanterie coloniale, le 1er janvier 1901 - Mis à la disposition du Général commandant en chef à Madagascar, le 1er avril 1901 - Embarqué à Marseille à destination de Madagascar, le 10 mai 1901 - Affecté au 3ème régiment de Sénégalais, le 19 août 1901 - Nommé Lieutenant, le 1er octobre 1901 - Affecté au 1er régiment de tirailleurs malgaches, le 29 octobre 1901 - Rentré en France, débarqué à Marseille, le 20 juillet 1904 - Affecté au 6ème régiment d'infanterie coloniale, le 29 juillet 1904 - Embarqué à Marseille à destination de Madagascar, le 25 février 1905 - Affecté au 2ème régiment de tirailleurs malgaches, le 13 mars 1905 - Participe à la colonne de Farafaugarra - Rentré en France, débarqué à Marseille, le 13 avril 1908 - Médaille coloniale avec agrafe Madagascar - Affecté au 2ème régiment d'infanterie coloniale, le 13 avril 1908 - Embarqué à Marseille pour le Maroc, le 1er avril 1909 - Affecté au 2ème bataillon de tirailleurs sénégalais du Maroc, le 5 avril 1909 - Participe à la colonne de Talda - Citation n° 23 à l'ordre du corps de débarquement de Casablanca, le 21 juillet 1910 - Rentré en France, débarqué à Marseille, le 7 juillet 1911 - Affecté au 7ème régiment d'infanterie coloniale, le 7 juillet 1911 - Participe à la colonne de Fez - Médaille Maroc avec deux agrafes dont "Casablanca" - Nommé Capitaine, le 25 décembre 1911 - Détaché à l'école d'aviation de Versailles, le 8 juillet 1912 - Chef de la 23ème section d'aéronautique - Brevet de pilote délivré par l'Aéroclub de France n° 1233, délivré le 7 mars 1913 - Commandant du centre d'aviation de Toul, le 25 juin 1913 - Brevet de pilote militaire n° 298 obtenu le 28 juin 1913 - Chevalier de la Légion d'Honneur et citation à l'ordre de l'armée, en date du 10 juillet 1913 - Placé en position hors cadre aéronautique, le 23 décembre 1913 - Commandant du centre d'aviation du camp de Châlons, le 29 décembre 1913 - Commandant de la 1ère réserve d'aviation n° 3, le 2 août 1914 - Commandant de la réserve générale aviation (RGA), le 15 novembre 1914 - Nommé Chef de bataillon à titre temporaire, le 21 janvier 1915 - Adjoint au commandant de l'aéronautique de la 2ème armée à Souilly (Meuse), le 20 décembre 1916 - Adjoint au colonel commandant le 5ème régiment d'infanterie coloniale, le 27 mars 1917 - Commandant le 3ème bataillon du 5ème régiment d'infanterie coloniale, le 7 avril 1917 - Blessé d'un éclat d'obus à la face, le 16 avril 1917 - Citation n° 118 à l'ordre du 2ème corps d'armée, en date du 3 mai 1917 - Directeur du service des entrepots généraux de l'aviation, le 23 décembre 1917 - Nommé Chef de bataillon à titre définitif, le 19 avril 1918 - En congé sans solde de 2 ans, à compter du 25 juin 1919 - Réintégré et affecté à l'entrepot spécial d'aviation n° 2 de Nanterre, le 18 juin 1921 - Officier de la Légion d'Honneur, le 12 juillet 1921 - Nommé Lieutenant-colonel de réserve, le 15 décembre 1921 - Affecté dans la réserve au magasin général d'aviation n° 4, le 29 juin 1923 - Hospitalisé à l'hôpital du Val-de-Grâce, le 12 janvier 1932 - Décédé à l'hôpital militaire de Val-de-Grâce (Paris), le 17 février 1932 - Sources : Bulletin de naissance - Pam - LO - Etats de services - JORF - Bulletin de décès - Dernière mise à jour : 22 septembre 2015.
* Citation n° 23 à l'ordre du corps de débarquement de Casablanca, le 21 juillet 1910 : "Commandait une section d'arrière garde au combat de Sidi-Schah, le 23 juin 1910 où il s'est brillamment conduit."
* Citation n° 118 à l'ordre du 2ème corps d'armée, en date du 3 mai 1917 : "Au combat du 16 avril, a commandé son bataillon d'une façon remarquable, assurant par l'engagement des compagnies strictement nécessaires l'enlévement et l'occupation de la position conduite."
* Officier de la Légion d'honneur du Chef de Bataillon Louis Xavier Joseph Joachim, de l'infanterie coloniale de l'entrepot spécial d'aviation n° 2, en date du 12 juillet 1921 : "Chevalier du 10 juillet 1913, 28 ans de services, 14 campagnes, une blessure, une citation."
Décision de création d'un centre d'aviation à Dijon :
Le 5 décembre, le ministre de la Guerre a averti la municipalité de Dijon qu'il avait approuvé la création d'un centre d'aviation militaire à Dijon. Des mesures seront prises très prochainement pour l'organisation de ce centre.
Une commision d'aviation russe en France :
Le 9 décembre, une commission spéciale militaire, chargée d'étudier les perfectionnements de l'aviation, est partie pour Paris. Elle est composée du général Schiskowitsch, du colonel Niemtschenke et de l'ingénieur Kouznetzoff.
L'escadrille Blériot de Casablanca :
Le 29 décembre, les pilotes de l'escadrille de Casablanca ont effectués, en moins de 5 jours, plus de 2.500 km. Le Cne Hervé et le MdL Peretti ont fait chacun le voyage Casablanca-Fez et retour, soit 600 km ; le MdL Feierstein, le voyage Casablanca-Marrakech-Mogador-Casablanca, soit 750 km ; le Ltt de la Morlais, le voyage Casablanca-Marrakech et retour, soit 500 km. Toutes ces missions ont été effectuées sur des Blériot XI-2 biplaces en tandem.
Création de la direction de l'aéronautique :
Le 31 décembre 1913, création de la direction de l'aéronautique, le général Besnard en est nommé directeur.
|



